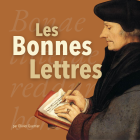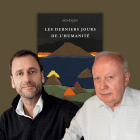Si les sociétés antiques constituent bien cet « espace alternatif » provoquant un dépaysement absolu, il arrive parfois au lecteur curieux de tomber sur un texte qui semble faire écho aux préoccupations les plus actuelles. Ce sont ces textes et les perspectives qu’ils ouvrent sur notre époque que cette chronique entend explorer : avec cette conviction que l’intérêt présenté par l’Antiquité ne saurait se réduire ni à « un roman des origines » ni à un humanisme intemporel qui resterait insensible aux mutations des sociétés.
« Les enfants ! Où sont les enfants ? » Au début de La maison de Claudine, on voit une mère inquiète chercher vainement, dans une scène apparemment coutumière, filles et fils égaillés dans la nature et retenus par différentes occupations silencieuses. Parmi celles-ci, on peut citer la lecture, le plaisir pris à émailler le jardin de petites pierres tombales découpées dans du carton, ou encore la course à travers bois où la plus jeune – narratrice double de Colette – goûte les charmes d’une liberté qui s’abreuve à tous les attraits de la campagne : « je glanais la mûre, la merise, ou la fleur, je battais les taillis et les prés gorgés d’eau en chien indépendant qui ne rend pas de comptes... »
Autres temps, autres mœurs ? Voici comment Longus, rhéteur grec contemporain de l’empereur Hadrien, évoque dans son roman pastoral les passe-temps de Daphnis et Chloé :
Leurs jeux étaient jeux de bergers et d’enfants (paidika). Elle allait çà et là cueillir des joncs dont elle faisait un couffin à mettre les cigales, ne se souciant aucunement de son troupeau ; cependant que d’un autre côté, il allait couper les roseaux dont il perçait les jointures, puis les collait ensemble avec de la cire molle, et apprenait à en jouer jusqu’à la nuit [1]. »
Les deux héros du récit ont une quinzaine d’années quand ils se retrouvent à garder les troupeaux, et ils ne vont pas tarder, en toute innocence, à découvrir le désir et l’amour… Si le texte de Colette est largement autobiographique, le récit de Longus s’inscrit dans la tradition des idylles de Théocrite et de Virgile. Mais l’évocation précise des jeux d’enfants auxquels s’adonnent ici les deux personnages est très rare dans l’Antiquité : sur ces questions, fait inhabituel, les trouvailles archéologiques nous en apprennent plus que la littérature.
Le grec ancien, chose assez étonnante à constater, ne dispose pas de mot spécifique (substantif abstrait) pour désigner l’enfance. Si l’on ouvre le Bailly, on s’aperçoit vite que le terme pais (enfant) donne lieu à deux séries sémantiques distinctes : celle de l’éducation (paideia, paideuô etc.) et celle du jeu, de l’amusement sans conséquence (paidia, paizô, etc.) Or si la littérature, de Platon à Plutarque [2], fait la part belle à la paideia, elle ne s’intéresse guère à la vie enfantine. Autrement dit, tout se passe comme si l’enfance, invisible, était d’emblée absorbée par l’âge adulte, soumise au devoir de bien préparer, grâce à l’éducation morale qui s’impose, les vertus nécessaires au futur citoyen. La théorie abstraite de la paideia vient occulter les jeux et autres futiles occupations correspondant à la paidia… Les biographies de l’Antiquité, tout en mentionnant souvent l’ascendance des grands hommes, ne commencent réellement qu’avec leur entrée dans la vie publique, sans rien dire de la période qui précède. On peut trouver cependant chez Plutarque, dans la Vie de Thémistocle, une exception qui confirme cette règle :
Encore enfant il fut, assure-t-on, plein d’ardeur, d’une nature réfléchie, attiré par les grandes actions et par la politique. Dans les moments de détente ou de loisir que lui laissaient ses études, jamais il ne jouait ou ne s’abandonnait à l’insouciance comme les autres enfants ; mais on le trouvait s’exerçant à déclamer et composant des discours pour lui-même [3]. (…)
On voit ainsi que si Plutarque évoque le jeune âge de Thémistocle, c’est justement dans la mesure où celui-ci ne se comporte pas en enfant, mais témoigne déjà de la gravité d’un adulte en se tournant vers les centres d’intérêt qui marqueront sa vie future. Quant aux enfants épars dans les fables d’Ésope, ils n’offrent pas plus de consistance que le reste de ses personnages, humains ou animaux, simples figures sans épaisseur au service d’une morale conclusive.
Si l’on se reporte à l’époque moderne, le contraste est saisissant : l’enfance constitue un objet littéraire à part entière, les poètes y puisent leur inspiration, les différentes autobiographies (ou autres autofictions) y voient volontiers la clef d’une existence. Une phrase comme celle de Baudelaire : « Le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté » est évidemment impensable dans l’Antiquité. Bien loin d’être tenue pour négligeable, l’enfance est de nos jours plutôt présentée comme une source qui alimente le reste de la vie, pour le meilleur ou pour le pire – du « vert paradis des amours enfantines » aux traumatismes divers, beaucoup analysés actuellement, susceptibles de laisser des traces indélébiles. Bien sûr la psychanalyse est passée par là, mais les écrivains n’ont pas attendu Freud pour s’intéresser aux premières années de l’existence. On voit souvent en Rousseau l’initiateur de cette attitude : le début de ses Confessions montre ainsi comment ses premières lectures, romans et surtout livres antiques, forgent son caractère, ou encore comment les chansons douces de sa tante expliquent son goût pour la musique. Il semble bien en effet qu’avant Rousseau, de Rabelais à Fénelon, l’enfance reste encore étouffée sous les exigences de la paideia [4]. Il est vrai que l’auteur de Gargantua décrit avec une certaine complaisance, voire une sorte d’ivresse verbale, les divertissements débridés de son jeune héros : mais c’est pour mieux montrer comment plus tard ses pédagogues, en particulier Ponocrates, mettront bon ordre à ce dérèglement en canalisant l’énergie débordante de leur élève...
Le succès de l’enfance va de pair avec l’apparition de l’autobiographie et l’intérêt naissant pour la vie privée – et ce n’est pas un hasard si tout cela coïncide avec l’avènement du romantisme. L’idée initiée par l’auteur des Confessions est en effet celle de la singularité des individus : « j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent », alors qu’on peut appliquer à tous les classiques le mot de Pascal (qui se charge par ailleurs d’autres significations) « le moi est haïssable ». De même quand Montaigne insiste sur la dimension autobiographique de ses Essais, il se présente non comme une exception mais comme un simple échantillon de l’humanité, dans la mesure où « chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition. » Or qui évoque son enfance, à l’inverse, suggère toujours peu ou prou qu’il a vécu quelque chose de spécifique, une expérience originelle qui fait de lui l’être particulier qu’il est devenu.
On n’observe rien de tel dans l’Antiquité. Même si, avec Laure de Chantal, on peut saluer en Sappho « la première personne à écrire en son nom propre [5]» en faisant partager ses émotions, force est de constater que son exemple n’a guère été suivi dans la littérature grecque et que, même chez les Latins, les traces autobiographiques sont assez limitées : un petit nombre de pièces lyriques – en particulier les poèmes de Catulle dédiés à Lesbie, dont la sincérité s’impose au lecteur, le pacifisme de Tibulle [6], quelques confidences d’Horace [7], la correspondance de Cicéron… Mais, même dans ce type d’écrits, les références à l’enfance sont quasiment nulles… Quant à Saint Augustin, si petit enfant et si grand pécheur [8] (!), comme il se dit lui-même, ses allusions à sa prime jeunesse sont déjà noyées dans le souci argumentatif de ses Confessions, et cette période de sa vie, peu développée, ne présente pour lui d’autre véritable intérêt que de corroborer le propos général de son œuvre...
Où sont les enfants ? Inutile de les chercher dans les écrits de l’Antiquité, pour une raison assez simple : dans ce type de société, ils n’existent pas. Les Grecs – et singulièrement les Athéniens – ont inventé beaucoup de choses : la démocratie, le théâtre, la philosophie… Mais ce ne sont pas eux qui ont inventé l’enfance.
J-P P.
[1] Longus, Daphnis et Chloé, I, 10, trad. Christophe Donner (Le Seuil).
[2] Outre ses Vies Parallèles, Plutarque est l’auteur d’un traité sur l’éducation assez représentatif des préoccupations exposées ci-dessous.
[3] Plutarque, Vie de Thémistocle, II, 1.
[4] Notons cependant que deux siècles avant Rousseau La vie de Benvenuto Cellini écrite par lui même offre quelques pages consacrées à son enfance. Le livre ne fut publié qu’en 1728.
[5] Laure de Chantal, Les neuf vie de Sappho, Introduction et chapitre I (Stock, 2023).
[6] cf. Élégies, I, 10.
[7] cf. par exemple, ici-même, Horace et le bonheur des livres.
[8] Confessions Livre I, 12.
Dans la même chronique

Grand écart – Moi et les autres

Grand écart – Glissements progressifs des régimes
Dernières chroniques