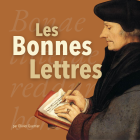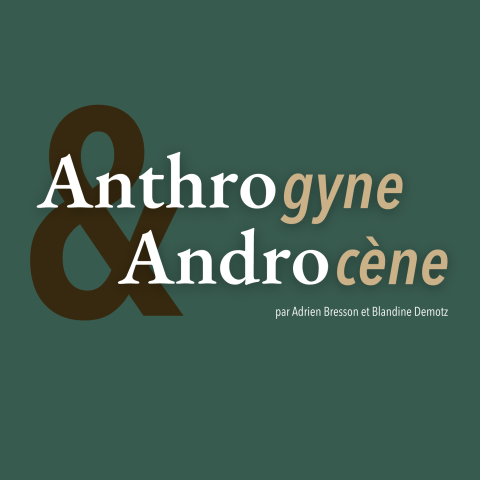
Le grec ancien a deux mots, bien distincts, pour distinguer l'être humain (anthropos) et l'homme, conçu comme être masculin (andros). La femme (gunè) est donc un anthropos au même titre que l'andros. Pour autant, les civilisations anciennes, dans leurs mythes notamment, ne manquent pas de mettre en scène des entités détachées de tout genre, ou au contraire aux genres pluriels, parfois androgynes, ou au-delà. Sont-elles alors à percevoir comme anthrogynes, dépassant le stade de la masculinité et faisant route vers l'humain, au sein même de sociétés androcènes, et donc patriarcales ? En étudiant les rapports de genre parmi les textes et les représentations anciennes, de l'Antiquité à sa réception contemporaine, Adrien Bresson et Blandine Demotz invitent à repenser les représentations stéréotypées du masculin, du féminin et du neutre.
La société de l’Antiquité tardive est bien différente des sociétés classiques d’époque républicaine ou encore d’époque impériale du point vue de la manière dont s’exerce la romanité. En effet, contrairement à la société romaine traditionnelle du début du millénaire, au IVe siècle de notre ère, le monde romain a connu une christianisation massive, ce qui modifie le rapport des Anciens au corps, à la norme et à la sexualité qui demeure très hétéronormée si l’on observe les écrits des Pères de l’Église, ces individus qui défendent une lecture convaincue des textes bibliques. Cependant, au-delà des Pères de l’Église, si l’on prend le cas d’Ausone et de Claudien, deux poètes du IVe siècle, l’on constate que ces derniers ne sont jamais présentés comme des chrétiens strictement convaincus, de telle sorte que même si le prisme de la société dans laquelle ils s’inscrivent doit pouvoir rejaillir sur leur vision, il apparaît malgré tout que c’est leur position sociale qui exerce la plus grande influence sur leur production littéraire. Ausone est en effet un ancien professeur, repéré par l’empereur Valentinien pour devenir le précepteur de son fils Gratien, avant que ce même Gratien, devenu empereur, ne nomme Ausone consul pour l’année 379. Claudien, quant à lui, est un Égyptien venu à Rome et devenu poète officiel. Il a donc un rapport de hiérarchie descendante par rapport au pouvoir, dans le sens où en tant que panégyriste officiel de l’Empire, il s’agit pour lui de répondre à des commandes – en tant que poète de circonstances – et de présenter la vision la plus positive qui soit de l’Empire. Alors même que le lecteur du XXIe siècle aurait pu attendre de la part d’individus si proches du pouvoir en place, dans des sociétés christianisées – même si les deux poètes ne le sont pas véritablement – des écrits relativement chastes, il apparaît malgré tout que plusieurs poèmes, plus ou moins longs, aussi bien d’Ausone que de Claudien, mentionnent la sexualité à plusieurs titres, aussi bien en rapport avec les personnes qui sont en charge du pouvoir, qu’avec d’autres individus peu connus et parfois non nommés. L’objet de ce nouveau chapitre de la chronique Anthrogyne et androcène est d’étudier le lien entre norme sexuelle et norme de genre en se demandant si l’intention, liée à l’évocation de la sexualité par les poètes dans un contexte relativement officiel, est de mettre au jour l’existence d’une norme sur le plan de la sexualité dans l’Antiquité tardive, ou au contraire de l’interroger. Pour ce faire, en partant d’une vision apparemment hétéronormée de la société, nous verrons, au fil des chroniques, qu’il existe également une sortie de la norme de la part de certains individus, ce qui est à mettre en perspective avec un rapport pluriel au genre et à la sexualité. Enfin, du point de vue de la création littéraire que mettent en place les deux poètes, il sera important de se demander si le fait qu’ils abordent la sexualité et si l’écart qui existe entre norme et sortie de norme, ne seraient pas à mettre en lien avec l’intention littéraire qui préside souvent à l’écriture.
Il n’y a pas d’uniformité des sociétés antiques du point de vue de la pratique des unions en tant que telles, si bien que l’union dite homosexuelle par exemple – bien que ce terme soit tout à fait anachronique pour l’époque –, paraît relativement usuelle, dans la Rome républicaine. De ce point de vue, la société romaine tardive est en partie différente parce qu’elle a connu la christianisation, de telle sorte que sur le plan de la vie sociale, l’union hétéronormée, entre un homme et une femme, est particulièrement prégnante, surtout en ce qui concerne les sociétés dans lesquelles évoluent les poètes Ausone et Claudien. En effet, parce qu’ils sont proches du pouvoir, il apparaît évident que la vision sociale de l’union qui est renvoyée dans les poèmes d’Ausone et de Claudien répond de la vision sociale prégnante à leur époque. Ainsi, Ausone, dans son recueil des Parentalia, établit le portrait des défunts de sa famille. Il décrit alors des couples hétéronormés, signalant à chaque fois, lorsque le contexte s’y prête, l’union maritale d’un homme et d’une femme que la seule désignation biologique suffit à réduire au statut d’homme ou de femme. De la même manière, son Centon nuptial, en plus d’être le résultat d’un jeu littéraire reposant sur une prouesse particulière, a pour intérêt principal de développer la thématique de l’union entre deux individus que le mariage contribue à mettre en lien. Il s’agit évidemment d’un homme et d’une femme, ce sur quoi le poète insiste lorsqu’il aborde, entre autres, la thématique de la nuit de noces telle qu’elle se déroule entre les deux individus. Prenons également l’exemple du poème d’Ausone intitulé Bissula. Il s’agit alors pour le poète de proposer la célébration fictive d’une jeune barbare qu’il lui aurait été donné de voir et pour laquelle il éprouve, apparemment, de forts sentiments d’attachement. Encore une fois, c’est une vision hétéronormée qui est renvoyée par le poète.
Un tel aspect semble pouvoir être confirmé en observant la production littéraire de Claudien qui, quant à lui, se borne au portrait de couples hétérosexuels, renvoyant une vision hétéronormée de la société à laquelle il appartient. Ainsi, le régent de l’Empire romain d’Occident Stilicon est uni à la régente Sérène. Lorsque l’empereur Honorius se marie dans des noces romaines traditionnelles, il s’unit alors à la fille de Stilicon et de Sérène, appelée Marie. À cette occasion, Claudien consacre à leur union un épithalame, c’est-à-dire un poème composé pour célébrer un mariage. Le fait que le poète officiel de l’empire compose un poème à cette occasion est particulièrement éloquent sur le plan de la norme. En effet, le rôle premier du poète officiel est avant tout de célébrer ce qui est à même de constituer un objet de réjouissance collectif dans un contexte impérial officiel. Par conséquent, le fait que le mariage de l’empereur soit célébré n’est pas étonnant puisqu’il s’agit d’un événement particulièrement important pour l’Empire, notamment d’un point de vue social et politique. Qu’une union hétérosexuelle fasse l’objet d’un poème officiel est caractéristique de ce qui peut apparaître comme étant la norme. D’ailleurs, lorsque Claudien mentionne sa propre union, dans un poème qu’il adresse à la régente Sérène, il est particulièrement marquant qu’il s’agisse encore une fois d’une union avec une femme. Une telle insistance, de la part des poètes que sont Ausone et Claudien, sur la vision hétéronormée de la société, tout du moins sur le plan social, semble être un indicateur particulièrement fort de l’existence d’une norme dans l’Antiquité tardive, du moins dans la sphère publique. Toutefois, les sociétés grecques et romaines d’époque classique faisaient une différence entre l’union sociale hétérosexuelle, consistant à vivre avec une femme, et l’union sexuelle qui pouvait ne pas être exclusivement hétérosexuelle. Cet aspect reste à observer afin de voir si Ausone et Claudien, qui ne sont pas des poètes de l’époque classique mais tardifs, mettent en avant une vision strictement hétérosexuelle de l’union sexuelle – qui dépasse donc le cadre des relations strictement sociales –, ou bien s’ils laissent la place à une sortie de la norme qui semblait prévaloir.
Adrien Bresson et Blandine Demotz
Dans la même chronique


Dernières chroniques