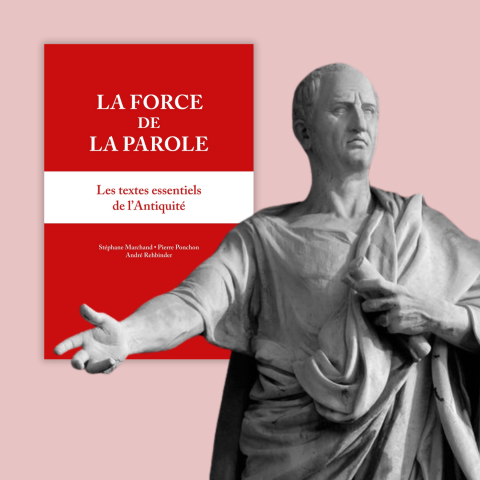
D’Homère à Libanios, l’Antiquité n’a cessé de réfléchir à la puissance paradoxale de la parole : instrument de séduction et de persuasion, outil de justice ou d’autorité, mais aussi source de crainte et de méfiance. Avec La Force de la parole (Les Belles Lettres, 2025), Stéphane Marchand, Pierre Ponchon et André Rehbinder offrent un panorama unique de textes, du VIIIᵉ siècle avant notre ère au IVᵉ siècle après, réunis autour de cette question centrale. Ils nous accordent un entretien exclusif pour évoquer la genèse de l’ouvrage, ses enjeux pédagogiques et ce que la voix des Anciens peut encore nous dire aujourd’hui.
La Vie des Classiques : Pour commencer, comment vous présenteriez-vous en quelques mots ?
Stéphane Marchand : Je suis maître de conférences en histoire de la philosophie ancienne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; mes recherches portent sur la tradition sceptique et le problème de la connaissance dans l’Antiquité. C’est dans le cadre de mes recherches sur le doute, l’incertitude, la vraisemblance et la variété des formes d’argumentation que j’en suis venu à m’intéresser aux phénomènes rhétoriques et aux rapports entre philosophie et rhétorique.
Pierre Ponchon : Je suis actuellement professeur de philosophie en lycée où j’enseigne en classe de terminale et en classe de première pour la spécialité HLP [Humanités, Littérature et Philosophie]. J’interviens aussi comme chargé de cours en philosophie ancienne pour la Licence de philosophie. Parallèlement, je poursuis des recherches en philosophie ancienne, principalement sur la philosophie politique de Platon et le platonisme politique.
André Rehbinder : Je suis maître de conférences en langues et littératures grecques à l’Université Paris Nanterre. J’ai une formation littéraire, et non philosophique, au sens où j’ai passé l’agrégation de lettres classiques et que ma thèse est enregistrée en études grecques. Toutefois, mon objet d’études principal est l'œuvre de Platon, que j’aborde du point de vue du style et du dialogue. Je m’intéresse en particulier aux liens entre Platon et la poésie d’une part, la rhétorique de l’autre.
L.V.D.C. : Comment est née votre passion de l’Antiquité ? Un souvenir, un professeur, une lecture marquante ? Comment avez-vous ensuite « entretenu la flamme » ?
S. M. : J’ai eu la chance d’être élève dans un petit collège de la Porte d’Italie dans le XIIIe arrondissement de Paris et d’y avoir comme professeur de lettres Jean-Michel Lascoux qui m’a rapidement convaincu de faire du latin et du grec. Ses cours étaient passionnés, d’une richesse incroyable ; ils étaient aussi très suivis, y compris par des élèves de milieu modeste, dont certains apprenaient le latin ou le grec à peu près en même temps que le français. Nous étudiions beaucoup de poésie et je me souviens encore de la fons Bondusiae d’Horace qu’il nous avait fait apprendre par cœur. Il m’a appris beaucoup de ce qui m’importe encore aujourd’hui, notamment l’amour de la littérature et de la philosophie ; il a changé la vie, je crois, d’un grand nombre de ses élèves. La lecture de Platon a pris la suite. Même si je me suis éloigné un temps des langues anciennes, durant mes études de philosophie, il était plus ou moins évident pour moi qu’à la fin je me spécialiserais en philosophie ancienne.
P. P. : La passion est née dans mon milieu familial, puisque c’est mon père qui m’a initié au grec ancien et qui m’a assisté dans le travail de traduction jusqu’à ma thèse de doctorat. J’ai également été marqué durant ma scolarité par la tragédie (je me souviens très bien de l’étude d’Œdipe-Roi de Sophocle en classe de terminale). Mais c’est essentiellement par le biais de la philosophie antique que s’est perpétué le goût de l’Antiquité, à travers la langue grecque. Ensuite, la lecture de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide a marqué un jalon important. Mon rapport à la langue latine est plus tourmenté.
A. R. : À la fin de mes études secondaires, j’ai compris que je voulais me consacrer à la littérature. D’abord, je voulais être professeur de lettres modernes ; et puis, j’ai eu un professeur de khâgne extraordinaire, Luc Amiech, qui a été à la fois mon professeur de latin et de français. C’est lui qui m’a fait sentir le lien qui unit la littérature française à la littérature antique et qui m’a amené à choisir les lettres classiques. Une autre expérience fondatrice a été la traduction d’un extrait du livre II de la République de Platon lors de la préparation de l’agrégation : il était tiré des éloges paradoxaux de l’injustice que font les deux frères de Platon, Glaucon et Adimante. Ce sont des textes saturés de références littéraires – le texte en question faisait allusion à la « renarde d’Archiloque ». Depuis, je n’ai plus quitté la prose d’art platonicienne.
L.V.D.C. : Vous rappelez-vous du premier texte latin et/ou grec que vous avez lu et/ou traduit ? Quel souvenir en gardez-vous ?
P. P. : Je ne me souviens pas précisément du premier extrait traduit, mais j’ai en mémoire les premiers ouvrages complets que j’ai traduits. C’était dans le cadre du programme de grec du baccalauréat, nous devions préparer pendant toute l’année deux œuvres : Les Nuées d’Aristophane et l’Apologie de Socrate de Platon. J’en garde le souvenir d’une expérience entièrement neuve pour moi et qui ouvrait de nouveaux horizons : jusqu’ici, je n’avais traduit que des extraits de quelques lignes. En plus, cela coïncidait avec la découverte de la philosophie ; or nous étudiions justement en cours de philosophie l’Apologie de Socrate. Les deux consonnaient ; cela faisait vraiment sens et je gardais en tête d’associer les deux disciplines.
S. M. : Je me souviens de la traduction suivie du chant IV du De rerum natura pour passer le baccalauréat ; pouvoir accéder à une pensée complexe dans sa langue originale m’a fasciné, j’avais l’impression d’accéder à quelque chose qui autrement m’était caché ; j’ai retrouvé ce même plaisir quand j’étudiais Descartes, Spinoza, et même Kant, en latin. J’ai mis plus de temps à accéder à des œuvres intégrales en grec – mais les années passées avec Pierre Ponchon à traduire des dialogues de Platon et à les discuter m’ont énormément appris.
A. R. : Les tout premiers textes antiques que j’ai traduits étaient les élégies de Tibulle, que nous avions au programme au lycée. Nous les commentions avec une autre professeur remarquable, Dominique Crozat. Je me souviens du plaisir que je prenais à découvrir, grâce à elle, les allitérations et autres jeux phoniques dont les élégies sont truffées.
L.V.D.C. : Vous publiez un ouvrage rassemblant un vaste panorama de textes, du VIIIe siècle avant notre ère au IVe siècle après, issus majoritairement des traductions publiées aux Belles Lettres, autour d’une question centrale dans l’Antiquité : la force de la parole. Comment est née l’idée de ce recueil ?
P. P. : À la suite de notre travail de traduction du Gorgias de Platon suivi de L’Éloge d’Hélène de Gorgias, Stéphane et moi avions eu le sentiment de ne pas vraiment avoir pu aborder la question de la postérité de la polémique entre la rhétorique et la philosophie. Nous avions d’abord envisagé de placer quelques textes en annexe de notre traduction, mais très vite l’importance des points à aborder et le volume de textes à prendre en considération nous ont convaincu de la nécessité de construire une anthologie commentée. Cela nous a permis d’ouvrir l’horizon temporel et conceptuel et a nécessité l’aide d’autres spécialistes (en particulier pour les questions littéraires et rhétoriques). André a alors accepté de s’associer à nous et de participer pleinement à la construction et à la réalisation de ce projet.
S. M. : C’est notre éditrice, Caroline Noirot, qui nous a soufflé l’idée alors que nous travaillions, Pierre et moi, à la réédition de notre traduction du Gorgias et réfléchissions à l’enrichir par un dossier de textes complémentaires dont le projet a vite dépassé le format de départ. Pour ma part, ce dossier me paraissait nécessaire parce que j’avais le sentiment d’avoir beaucoup travaillé le discours théorique sur la rhétorique et qu’il était temps de faire le lien avec l’étude des pratiques rhétoriques réelles.
A. R. : Pour ma part, c’est Stéphane Marchand qui m’a contacté pour me proposer de participer au projet. L’anthologie faisait écho à mes travaux de recherche et à mes cours concernant l’histoire de la rhétorique et de l’argumentation : j’ai donc immédiatement été très intéressé.
L.V.D.C. : Le titre même de l’ouvrage insiste sur cette force paradoxale de la parole, tantôt célébrée, tantôt redoutée. Qu’est-ce qui rend la parole si fascinante dans l’Antiquité ?
P. P. : Il me semble qu’il y a une sédimentation progressive de plusieurs phénomènes. D’abord la fascination provient de la dimension politique de la parole dans la cité : c’est par elle qu’on prend et qu’on exerce le pouvoir dans les Assemblées et dans les tribunaux. Si cette fonction initiale tend à perdre de son importance avec la fin de la cité classique, puis avec l’installation de l’empire romain, elle est remplacée par une nouvelle fonction sociale et intellectuelle. La maîtrise de la parole devient le gage de l’appartenance à une élite sociale et culturelle et la rhétorique comme la philosophie entrent dans la formation de l’homme accompli (kalos kagathos).
S. M. : En constituant l’anthologie j’ai été frappé par une chose : la critique platonicienne de la rhétorique, que l’on trouve notamment dans le Gorgias et qui dénonce, entre autres, les dangers de la démagogie dans une cité où les procédures de décisions politiques sont discutées démocratiquement, se retrouve dans un grand nombre de textes avant Platon ; c’est en réalité une sorte de lieu commun dès Homère de souligner cette force paradoxale de la parole autour de laquelle s’est constituée une grande partie de la culture grecque classique.
A. R. : Avant même que la parole ne devienne l’instrument principal de l’influence dans le régime démocratique, la Persuasion, Peithô, était célébrée comme une déesse par les Grecs. Dans certaines représentations que nous avons conservées, elle est associée à Aphrodite : c’est donc sans doute dans le domaine amoureux que le pouvoir de la parole a été ressenti et admiré en premier lieu. De façon générale, le phénomène de la persuasion semble avoir été considéré comme un pouvoir quasi-magique : on en trouve une trace dans la description du pouvoir immense de la parole par Gorgias dans l’Éloge d’Hélène, ainsi que dans la notion de “psychagogie”, la capacité à mener les âmes, qui est évoquée dans le Phèdre de Platon.
L.V.D.C. : Concrètement, comment avez-vous construit ce recueil ? Quels critères ont guidé la sélection des textes, et comment avez-vous choisi de les organiser et de les commenter pour en faciliter la lecture ?
P. P. : Lors d’une réunion de travail nous avons mis tous les trois au point le plan général de l’ouvrage, adopté le principe d’un commentaire à la suite de chaque sélection d’extraits et décidé de ce fait de limiter les notes dans les textes aux renvois internes et aux éléments de civilisation nécessaires à la lecture. Puis nous nous sommes partagé le travail en attribuant à chacun une partie, c'est-à-dire la sélection des textes et la rédaction du commentaire associé à cette partie. Nous sommes donc partis d’un choix de textes en fonction des problèmes abordés dans chaque partie. Chaque partie à néanmoins été relue et les choix discutés en commun. Ces choix devaient permettre tout à la fois de donner à lire de grands textes canoniques, mais aussi des textes plus rares et nous avons cherché à couvrir l’intégralité de l’Antiquité afin de montrer la persistance des interrogations mais aussi les évolutions. Enfin, nous nous sommes limités aux textes en prose (à l’exception d’Homère car il est très souvent pris comme source et comme modèle) et nous avons aussi cherché à établir un corpus ouverts à tous les genres de la prose (philosophie, histoire, traités de rhétorique, discours, œuvres de fiction en prose).
S. M. : Pierre a très bien décrit le processus. Le principe général de présentation est venu du modèle indépassable d’anthologie que nous avons en philosophie hellénistique, le Long et Sedley, qui a été traduit chez GF par Jacques Brunschwig et Pierre Pellegrin[1], où les textes fondamentaux des doctrines sont donnés avec un commentaire ; je trouvais que c’était un bon modèle pour constituer notre anthologie. J’insiste enfin sur le fait que les choix de textes et les commentaires ont ensuite été tous discutés à trois (parfois longuement !), et les discussions ont souvent été passionnantes.
L.V.D.C. : Aux côtés des grandes figures comme Platon ou Aristote, vous avez choisi de mettre en lumière des auteurs aujourd’hui moins connus, tels Libanios ou Dion de Pruse. Qu’est-ce qui a motivé ces choix ?
P. P. : Il s’agissait d’abord de montrer l’amplitude du phénomène tant dans le temps en sortant de la Grèce classique pour intégrer des périodes plus tardives que dans les formes littéraires. La question de la parole n’est pas l’apanage de la seule philosophie, mais fait l’objet d’une approche réflexive dans les discours eux-mêmes (qui, à ce titre, ne sont pas uniquement illustratifs), dans les traités de rhétorique, dans les ouvrages d’histoire, dans les œuvres de fiction en prose. Cet élargissement contribue aussi à mieux saisir les continuités, les évolutions et les déplacements d’une époque ou d’un champ à l’autre. C’est cette diversité dans le temps et dans les formes que nous souhaitions donner à lire.
A.R. : Certains auteurs moins célèbres aujourd’hui, comme Antiphon, ont eu un rôle crucial dans le développement des techniques d’argumentation : il était naturel de leur réserver dans l’anthologie la place qu’ils occupent réellement dans cette histoire.
SM : Sur ce point, je dois reconnaître et remercier mes deux collègues qui ont apporté ces textes qui enrichissent en effet considérablement le tableau ; cet apport était absolument nécessaire. Pour ma part, par exemple, avec Fronton j’ai voulu donner un exemple de réponses possibles à toute la ligne critique de la rhétorique initiée dans le Gorgias de Platon. Mais tant d’autres textes auraient pu être ajoutés ! Comme ceux d’Aelius Aristide. En réalité nous avons été contraints d’éliminer un grand nombre de textes et le choix n’a jamais été facile. De même pour la théorie aristotélicienne de la métaphore, j’ai trouvé les développement du pseudo-Démétrios de Phalère très éclairants.
L.V.D.C. : Les auteurs antiques que vous rassemblez – poètes, rhéteurs, philosophes, historiens, … – ont chacun leur manière d’envisager la parole. Quels contrastes majeurs apparaissent dans ces textes ? Et quelles continuités voyez-vous malgré la diversité des époques et des genres ?
P. P. : De mon point de vue, la continuité majeure est précisément ce qui a donné le titre de l’ouvrage : la conviction que la parole a une puissance propre à même de rendre possible l’exercice d’un pouvoir de persuasion. Mais ce pouvoir peut être utilisé pour agir, pour connaître, pour représenter ou pour jouer (comme dans le cas de Philostrate). Nous avons aussi cherché à dégager des variations et des évolutions plus fines dans chaque partie comme l’évolution des techniques oratoires, des pratiques délibératives ou de la controverse entre le discours philosophique et la rhétorique.
S. M. : La question des dangers propre à la technique rhétorique comme technique de persuasion, donc de manipulation, me paraît une question qui traverse toute l’anthologie. On voit bien comment elle est déjà en germe dans la présentation de la figure d’Ulysse par Homère, soulignée dans certains discours rapportés par Hérodote et Thucydide et évidemment dramatiquement mise en scène dans le Gorgias de Platon. Une fois que Platon a produit sa critique de la rhétorique, on voit très précisément comment tous les auteurs qui se sont intéressés au problème ont cherché d’une manière ou d’une autre à répondre à l’exclusion platonicienne : Isocrate, Aristote, Cicéron, Quintilien, ... entre autres. Cette fortune du Gorgias – qui répond aussi à la popularité de Gorgias – est un cas fascinant de continuité où le même problème est repris, transposé, discuté malgré les évolutions historiques. Cette continuité est d’autant plus intéressante que tout autour a changé : la conceptualité philosophique, les institutions politiques, et même la langue. La véritable rupture viendra avec l’intégration de la tradition rhétorique en contexte chrétien, dans le de doctrina christiana d’Augustin, notamment. Mais c’est une autre histoire pour une autre anthologie.
A. R. : Ce qui m’a frappé en travaillant sur l’anthologie, c’est la prédominance, durant toute l’Antiquité, d’une vision de la parole par son impact sur le destinataire. Par exemple, l’enargeïa n’est pas définie en premier lieu par des procédés d’écritures, mais par son effet : c’est un texte qui donne au lecteur l’impression qu’il a sous les yeux ce dont il est question. Cette tendance à considérer la parole sous l’angle de son effet plutôt que de sa production me semble être un héritage de Gorgias, qui dans l’Éloge d’Hélène définit d’emblée la parole comme un “tout-puissant souverain” qui produit les “effets les plus divins” avec un corps “minuscule et quasi-invisible”.
L.V.D.C. : L’ouvrage a une dimension pédagogique évidente, puisqu’il s’inscrit dans le programme de première de la spécialité Humanités, Littérature, Philosophie, « Semestre 1 : les pouvoirs de la parole », qui se décline en trois axes : l’art de la parole, l’autorité de la parole, les séductions de la parole. Comment pensez-vous que les enseignants puissent s’emparer de votre recueil pour travailler ces thématiques avec leurs élèves ?
P. P. : L’un des buts de l’ouvrage est en effet d’offrir aux collègues de littérature française et de philosophie un outil de travail en proposant à la fois des textes très classiques et d’autres moins connus à étudier en cours, ainsi que des pistes d’analyse adossées à l’état récent de la recherche (à travers le commentaire). L’index raisonné est aussi un moyen de circuler dans l’ouvrage à partir de notions ou de problèmes. La structure même du livre correspond aux axes du programme sur les pouvoirs de la parole (art, autorité et séduction). Mais plus largement le volume peut servir à aborder les autres thèmes du programme de HLP et présente des aspects utiles pour l’enseignement du tronc commun de philosophie. Il a donc aussi été conçu dans une perspective scolaire, même si ce n’est pas un manuel.
S. M. : Comme je n’enseigne plus en Terminale depuis longtemps, je me garderai bien de donner des conseils à ce sujet ! L’idée en tout cas a été de donner des portions importantes de textes fondamentaux pour permettre à tout un chacun de prendre connaissance des données d’une question majeure, en évitant de rentrer dans les querelles d’interprétation, donc en produisant une proposition de lecture et d’interprétations de ces textes.
A. R. : La plupart des textes ont été pensés pour être compatibles avec le format d’une séquence de cours. Le fait de placer le commentaire à la fin permettait de donner des pistes aux enseignants, tout en préservant leur liberté pédagogique.
L.V.D.C. : L’ouvrage dépasse aussi le cadre scolaire : à quel public s’adresse-t-il plus largement ?
S. M. : Je pense que toute personne qui s’intéresse au discours, à la question de la persuasion ou de l’argumentation pourrait être intéressée par cette anthologie. Elle constitue aussi à mon avis une bonne introduction à la culture grecque et latine puisque ces textes ont des enjeux politiques, philosophiques et littéraires évidents.
A. R. : À mon avis, l’anthologie peut être utile aux citoyens dans leur pratique démocratique quotidienne, c’est-à-dire dans l’écoute des discours politiques et de leur commentaire dans les médias. Elle donne en effet des outils d’analyse du discours politique : pratiquer les textes rhétoriques antiques apprend à identifier le fondement d’un argument et le type de moyen de persuasion auquel il appartient. Cela permet de savoir plus précisément pourquoi et à quoi on donne son assentiment. Par ailleurs, la dernière partie de l’anthologie, « les pouvoirs de la fiction », pourra attirer l’attention des littéraires, de ceux qui s’intéressent au style et à ses procédés : dans l’Antiquité, la rhétorique et la littérature n’étaient pas des champs clairement distincts ; les auteurs du roman grec, en particulier, étaient d’abord des grands praticiens de la déclamation rhétorique, et appartenaient au mouvement de la « seconde sophistique ».
L.V.D.C. : Nous vivons aujourd’hui dans un monde saturé de paroles : réseaux sociaux, médias, politique… Peut-on dire qu’ils utilisent, consciemment ou non, les méthodes de la rhétorique antique ?
P. P. : Il y a clairement dans ce qu’on appelle aujourd’hui la « communication » des reprises de stratégies argumentatives qui proviennent de la rhétorique antique. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours conscient, mais c’est l’effet d’une tradition intellectuelle très longue. Cependant, à mes yeux, la principale différence est que la communication contemporaine intègre en plus d’un art de la parole persuasive, des techniques de production, et parfois de manipulation, des images, ce qui était très peu le cas dans l’Antiquité, du fait de la difficulté technique qu’il pouvait y avoir à produire des images autres que par la langue, qui, elles, ont été analysées par les Anciens dans le cadre de la rhétorique (métaphore, évidence, description). Or l’image non discursive obéit à des règles spécifiques qui ne sont pas forcément celles du langage. Aujourd’hui, la persuasion passe autant par le discours que par l’image, et souvent par l’association des deux et donc de deux techniques différentes.
S. M. : Oui, je suis d’accord avec Pierre : l’introduction des images et la réduction du discours à des slogans a décalé de manière conséquente les pratiques et il est probable que les communicants d’aujourd’hui cherchent surtout à court-circuiter les étapes du discours et du raisonnement telles qu’elles sont décrites dans les traités rhétoriques. Aristote avait déjà réfléchi sur les différents raccourcis que le raisonnement peut et même doit emprunter quand il s’agit de parler devant un public composite que l’on doit persuader rapidement ; mais il cherchait comment garder quelque chose qui reste de l’ordre du raisonnement. On trouve cependant – dans l'œuvre de Chaïm Perelman notamment et de ses successeurs de l’école de Bruxelles – des tentatives intéressantes pour essayer de comprendre les ressorts de cette nouvelle rhétorique.
A. R. : À mes yeux, si le format de la communication politique a beaucoup changé, l’ossature de l’argumentation est toujours la même, au sens où l'on reconnaît dans les prises de parole des hommes politiques actuels, même quand elles sont très brèves, comme une réplique dans une interview ou un tweet, les arguments employés par les orateurs attiques et codifiés par Aristote. Je suis souvent frappé de retrouver dans les paroles de tel responsable politique un argument vraisemblable ou un argument par l’exemple très proches de ceux qu’a théorisés Aristote. C’est pour cela que l’anthologie peut être un outil pour apprendre à écouter le discours politique.
L.V.D.C. : Pour conclure, si vous deviez retenir une citation grecque ou latine qui, à vos yeux, incarne le mieux la puissance de la parole, laquelle choisiriez-vous ? Et pour quelle raison ?
P. P. : J’apprécie beaucoup la phrase de Périclès dans Thucydide : « car la parole n’est pas à nos yeux un obstacle à l’action : c’en est un, au contraire, de ne pas s’être d’abord éclairé par la parole avant d’aborder l’action à mener » (οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴ προδιδαχθῆναι μᾶλλον λόγῳ πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν). Elle exprime à mon sens la raison d’être de la délibération démocratique et les vertus de la parole : rendre possible l’intelligence collective dans l’action et dans la connaissance. C’est un outil fondamentalement collaboratif ; d’où je crois, l’intérêt polyphonique d’une anthologie qui donne à entendre cette pluralité constructive des points de vue. Elle est aussi, plus modestement, ce qui a rendu possible notre travail à trois sur cette anthologie.
S. M. : J'ai été, pour ma part, fort marqué par la figure de Fronton que j’ai découverte grâce à Pascal Quignard et sa Rhétorique spéculative. Fronton s’adresse à l’empereur Marc-Aurèle dont il a été le professeur et lui reproche de délaisser la rhétorique pour la philosophie avec des images que j’adore : ce serait, dit-il, comme si pour nager on préférait « chercher à égaler la grenouille plutôt que les dauphins » ou chercher à voler « avec les ailes minuscules des cailles plutôt qu’avec la majesté des aigles » ; il conseille encore « il convient de combattre avec un glaive, mais que tu combattes avec un glaive rouillé ou éclatant, cela est important ». Ces images sont faites pour rappeler au philosophe-empereur l’importance et même la primauté du phénomène rhétorique ; et je trouve particulièrement intéressant qu’il prenne comme exemple Platon justement, comme un modèle de philosophe qui a pris particulièrement soin de la façon dont il écrivait la philosophie. Ces images m’ont marqué parce qu’elles expriment bien la nécessité, y compris pour le philosophe et peut-être même surtout pour le philosophe, de réfléchir sur la forme que prend l’expression de sa pensée, parce que finalement la forme et le fond sont difficilement séparables. Ce n’est pas un hasard si cette anthologie a été constituée par trois chercheurs qui travaillent sur des objets qui sont tous – certes d’une manière différente – à la croisée de la philosophie et de la littérature, des catégories qui ne sont pas vraiment pertinentes ici.
A. R. : À mon avis, la célèbre définition de Gorgias, à laquelle je faisais référence plus haut, contient plusieurs éléments qui ont fortement influencé toute la tradition rhétorique postérieure. Je la cite dans la belle traduction de mes deux co-auteurs : le logos « est un tout-puissant souverain, qui par le biais d’un corps minuscule et invisible accomplit les exploits les plus divins. » Non seulement Gorgias énonce avec force l’immense pouvoir du logos, mais encore il le voit comme un « corps », c’est-à-dire qu’il identifie sa matérialité comme la cause, ou l’une des causes, de son pouvoir. Une autre image, beaucoup plus anecdotique en apparence, mais très belle, est celle qu’emploie Quintilien pour expliquer la théorie des lieux : il compare les arguments à des poissons et les lieux aux différents types de milieux aquatiques où l’on trouve ces poissons. Il compare encore les lieux aux cordes de l’instrument par lequel s’accompagne le chanteur : si le chanteur pense trop aux cordes, au point que cela retarde sa voix, alors, il vaut mieux qu’il n’emploie pas d’instrument. Le bon musicien est celui qui n’a même plus besoin de penser aux cordes de l’instrument, tant il les connaît bien.
[1] Long Anthony Arthur et David Sedley, Les philosophes hellénistiques, Jacques Brunschwig et Pierre Pellegrin (trad.), Paris, Flammarion, coll. « GF », 2001, 3 vol.
Dans la même chronique

Entretien tragique avec Christine Mauduit
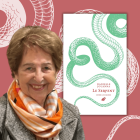
Entretien ophidien avec Danielle Jouanna
Dernières chroniques

Albums – Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte
