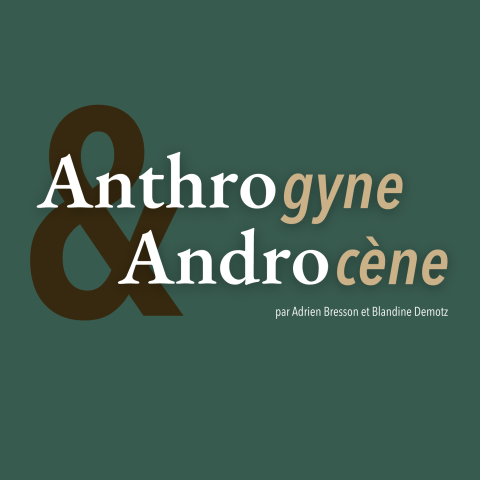
Le grec ancien a deux mots, bien distincts, pour distinguer l'être humain (anthropos) et l'homme, conçu comme être masculin (andros). La femme (gunè) est donc un anthropos au même titre que l'andros. Pour autant, les civilisations anciennes, dans leurs mythes notamment, ne manquent pas de mettre en scène des entités détachées de tout genre, ou au contraire aux genres pluriels, parfois androgynes, ou au-delà. Sont-elles alors à percevoir comme anthrogynes, dépassant le stade de la masculinité et faisant route vers l'humain, au sein même de sociétés androcènes, et donc patriarcales ? En étudiant les rapports de genre parmi les textes et les représentations anciennes, de l'Antiquité à sa réception contemporaine, Adrien Bresson et Blandine Demotz invitent à repenser les représentations stéréotypées du masculin, du féminin et du neutre.
Dans la précédente chronique, nous avons montré que les poètes Ausone et Claudien inscrivent leurs représentations de la sexualité dans un cadre fortement hétéronormé. Le mariage entre homme et femme y apparaît comme la seule union valorisée par la société et renforcée par l’influence croissante du christianisme. Ausone, à travers ses poèmes nuptiaux, insiste sur la complémentarité des rôles sexués et sur la fonction sociale du couple. Claudien, en célébrant notamment les mariages impériaux, donne à cette norme une portée politique et publique. Cependant, des tensions et écarts avec ce modèle transparaissent parfois, ouvrant la voie à d’autres interprétations du genre et de la sexualité.
Ausone et Claudien sont des poètes officiels qui entretiennent une proximité particulière avec le pouvoir, et leurs écrits ne manquent pas de mettre en scène la sexualité à travers une vision largement hétéronormée, ce qui est caractéristique du contexte dans lequel ils proposent leurs compositions littéraires. Il en va par exemple ainsi d’Ausone dans le cadre du Centon nuptial qu’il compose[1], qui célèbre l’union de deux individus. Dans le contexte de ce poème, se trouve évoquée la nuit de noces, que le poète présente ainsi :
Postquam congressi sola sub nocte per umbram
et mentem Venus ipsa dedit, noua proelia temptant.
Tollit se arrectum, conantem plurima frustra
occupat os faciemque, pedem pede feruidus urget.
Perfidus alta petens ramum, qui ueste latebat.
Après que, réunis sous la nuit désolée parmi les ombres, Vénus elle-même se fut aussi insinuée en leurs esprits, ils s’essaient à de nouveaux combats. Il se dresse tout droit, elle fait en vain de multiples efforts, il cueille sa bouche et son visage, ardent, un pied presse l’autre. Perfide, il va plus loin : son manteau cachait un bâton.
Ausone, Centon nuptial, v. 101-105 (traduction personnelle)
La mention de Vénus apparaît ici comme une métaphore de l’amour charnel auquel les deux personnages sont disposés à se livrer, et il est question des proelia, image usuelle de l’acte sexuel comme un combat que se livrent les individus. Notons que les rôles de chacun des deux individus sont présentés d’une manière caractéristique de sociétés hétéronormées, ainsi les actions sont accomplies par l’homme qui manifeste une forme évidente de virilité. Il tollit (« se dresse), tandis que les efforts faits par la femme sont dits frustra (« en vain »). Ses actions n’aboutissent pas à travers ce qui ressemble à une agression[2], contrairement à celles de l’homme qui produit des actions plurielles, notamment occupat os faciemque (« il cueille sa bouche et son visage »). En outre, le ramum dont il est question au dernier vers désigne le sexe de l’homme, qui est présenté comme une arme donc apte à blesser, selon l’image habituelle de conquête militaire, et traduit encore une fois la vision hétéronormée de la société. En miroir, le sexe féminin n’est pas nommé ni même suggéré. Est-ce parce que, chez le poète, il ne paraît nullement avoir le dessus ? Si l’on observe les formes grammaticales, l’homme agit, il est le sujet des verbes, comme tollit, tandis que – ce qu’échoue à rendre notre traduction – la femme n’en est que l’objet, en tant que conantem, à l’accusatif. Il y a par conséquent un partage des rôles, du point de vue sexuel, qui est à mettre en relation avec la dimension patriarcale des sociétés antiques. Il n’est dès lors pas étonnant que Claudien, lorsqu’il aborde la sexualité d’un point de vue officiel, en décrivant notamment la relation entre l’empereur Honorius et sa femme Marie, entre dans le détail d’une relation hétéronormée, comme si l’association avec le pouvoir ne pouvait qu’être perçue de la sorte. C’est dans les chants Fescennins, chants traditionnellement licencieux donnés à l’occasion des mariages, qu’il aborde ainsi leur union :
Et murmur querula blandius alite
linguis assiduo reddite mutuis.
Et, labris animum conciliantibus,
alternum rapiat somnus anhelitum.
Amplexu caleat purpura regio,
et uestes Tyrio sanguine fulgidas
alter uirgineus nobiliet cruor.
Que sans cesse vos langues échangent des soupirs plus caressants que la plaintive tourterelle. Et que dans l’union des âmes par les lèvres le sommeil vous saisisse haletants tour à tour. De l’étreinte royale que la pourpre s’échauffe ; que les tissus illuminés du sang de Tyr soient ennoblis par un autre sang, virginal.
Claudien, Œuvres. Tome 2. Poèmes politiques 395-398. 2e partie, Jean-Louis Charlet ed. Paris, CUF, 2000, v. 21-27.
La mention du caractère royale de l’étreinte jointe à l’image de la jeune vierge qui ne l’est plus le lendemain de sa nuit de noces, à la suite d’une union plus que suggérée illustre, comme chez Ausone, une vision hétéronormée de la sexualité, en association avec le pouvoir, dans l’idée d’une domination intrinsèque de la virilité masculine. Cette vision n’empêche malgré tout pas l’existence d’une sortie de cette même norme, comme nous le verrons dans les chroniques à venir.
Adrien Bresson et Blandine Demotz
[1] Le « centon » est une forme poétique caractéristique de l’Antiquité tardive. C’est un poème composé exclusivement de vers empruntés à un auteur prestigieux – le plus souvent Virgile – que l’on découpe et réassemble pour créer une nouvelle œuvre. Dans l’Antiquité tardive, ce procédé avait à la fois une valeur d’exercice érudit et de démonstration d’habileté littéraire. Le sens naît du détournement : en combinant des fragments connus, on construit un récit nouveau (par exemple un mariage, une épopée chrétienne ou une scène mythologique). Ce jeu d’imitation et de transformation montre la maîtrise de l’auteur, tout en conférant une autorité culturelle à son texte grâce à la voix virgilienne.
[2] Une telle image est habituelle dans un rapprochement que font régulièrement les Anciens entre acte amoureux et conquête militaire.
Dans la même chronique


Dernières chroniques

La Note Antique – La notation musicale
