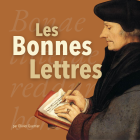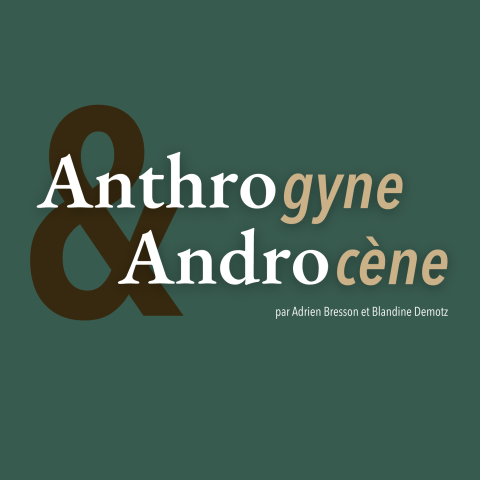
Le grec ancien a deux mots, bien distincts, pour distinguer l'être humain (anthropos) et l'homme, conçu comme être masculin (andros). La femme (gunè) est donc un anthropos au même titre que l'andros. Pour autant, les civilisations anciennes, dans leurs mythes notamment, ne manquent pas de mettre en scène des entités détachées de tout genre, ou au contraire aux genres pluriels, parfois androgynes, ou au-delà. Sont-elles alors à percevoir comme anthrogynes, dépassant le stade de la masculinité et faisant route vers l'humain, au sein même de sociétés androcènes, et donc patriarcales ? En étudiant les rapports de genre parmi les textes et les représentations anciennes, de l'Antiquité à sa réception contemporaine, Adrien Bresson et Blandine Demotz invitent à repenser les représentations stéréotypées du masculin, du féminin et du neutre.
L’une des particularités du mythe de la gigantomachie est que son écriture n’est pas cantonnée à la seule Antiquité : à l’époque moderne, plusieurs réécritures fleurissent. La dimension genrée, que nous avons observée au cours des précédentes chroniques, ne manque pas d’apparaître. Ainsi l’humaniste bourguignon Jacques Guijon, né à Autun à la fin de la première moitié du XVIe siècle, compose-t-il au début du XVIIe siècle une gigantomachie en latin. Divers éléments caractéristiques du mythe sont repris et les rôles qui avaient été assignés à chacun le sont à nouveau dans le mythe tel que Guijon l’aborde. Ainsi, l’entrée au combat de Minerve, également appelée Pallas, se déroule de la façon suivante, aux v. 171-195 :
Interea armipotens dira fremit aegide Pallas,
Et quibus aduersa praetendat Gorgonis ora,
Ora bis haud ulli conspecta impune, trucesque
Vipereo crine et monstroso lumine uultus
Quaerit (ab experta auersi nam peste feruntur),
Congressos Diuae Pallanta et Echiona fratres.
Nec plaga accepta, clypei tantum obice miri
Viderat in subitas alius durescere cautes,
Dum procul a tergo diuersis staret in armis,
Admonuitque suos : "Acies reflectite uestras,
Germani, et uisu nocituro parcite ; monstrum
Saxificum Pallas clypeo gerit ! Eminus haustis
Obriguere duo fratres in saxa uenenis".
Nondum desierat, satagentem et multa monentem
Objecta facie deprendit adhucque uidentis
Occupat ora, ferosque intentat ab aere dracones
Pallas. At huic gelido torpescunt pectora saxo,
Et membris sensim insinuat rigor atque loquentis
Subsidioque suo clamantis uerba meatu
Concrescunt medio uoxque intercepta gelascit.
Qualis marmorea tenet aethera mole Colossus
Assurgitque polis ingens aciemque fatigat,
Et subiecta minax prospectu territat arua,
Tale riget subita perculsum Gorgone monstrum
Vtque suo gestu cum marmore uiuus obhaesit,
Et spirare minas et adhuc bellare uidetur.
Pendant ce temps, Pallas-Athéna toute-puissante gronde, armée de sa sinistre égide, et aucun de ceux à qui elle tend de face le visage de la Gorgone ne voit impunément ce visage deux fois ; elle poursuit avec la chevelure vipérine et les yeux monstrueux les faces farouches de ses ennemis et, – car ceux-ci, dit-on, se sont détournés du fléau bien connu –, vise Pallas et Échion, des frères qui se sont attaqués à la déesse. Un autre, miraculeusement indemne grâce à la protection de son bouclier, les avait vus se transformer subitement en durs rochers, tout en se tenant lui-même, de dos, au loin, sous ses armes variées et il avertit les siens : "Détournez vos yeux, mes frères, et préservez-vous de ce regard nuisible ; c’est un monstre pétrificateur que porte Pallas sur son bouclier ! Pour avoir, de loin, absorbé de leurs yeux son venin, deux de nos frères ont été pétrifiés". Il n’avait pas encore fini de parler et s’évertuait à multiplier ses conseils quand Pallas le surprend, brandit la tête de Méduse et, comme il la regarde, elle s’empare de son visage et dirige contre lui, depuis le ciel, les féroces serpents. La poitrine du Géant s’engourdit et devient roche glacée, la rigidité s’insinue insensiblement en ses membres et, tandis qu’il parle encore et qu’il crie à l’aide, ses mots se bloquent au beau milieu de sa gorge et sa voix, interrompue, se gèle. Comme le Colisée occupe le ciel de sa masse de marbre, s’élève immense vers l’éther, épuise la vue et, menaçant, terrifie par son aspect les terres qui s’étendent à ses pieds, ainsi se dresse, tout raide, le monstre subitement frappé par la Gorgone ; il s’est figé dans le marbre mais semble vivant et, par son attitude, paraît exhaler des menaces et combattre encore.
Il est possible de considérer, à la lecture de cet extrait, qu’une divinité associée au féminin apparaît sur le champ de bataille et qu’il existe une évolution réelle des stéréotypes de genre, en comparaison avec l’Antiquité. Toutefois, Minerve n’est qu’une adversaire lointaine pour les Géants parce qu’elle ne combat pas en personne : c’est en réalité son égide, sur lequel se trouve une tête de Gorgone, qui accomplit pour son compte la pétrification des ennemis.
Dans une autre gigantomachie de la même époque, composée par le dramaturge Scarron (1610-1660) et intitulée Typhon ou la gigantomachie : poëme burlesque, la description qui est donnée des personnages féminins apparaît tout aussi genrée. Intéressons-nous portrait qui est donné de Junon dans le troisième chant, portrait d’autant plus marquant que Junon n’est pas un personnage caractéristique du mythe de la gigantomachie tel qu’il s’est répandu à travers l’Antiquité, si bien que son inclusion dans le champ narratif n’en est que plus remarquable :
À son cri Junon éveillée,
Vint à lui toute débraillée,
Et criant bien fort trahison
Éveilla toute la maison.
La manière dont est présentée Junon est caractéristique des stéréotypes de genre : elle est associée à une forme de nudité, et en même temps rattachée essentiellement à la parure, avec l’expression « toute débraillée ». Elle ne peut finalement agir qu’en produisant un cri d’une force si particulière qu’il réveille toute la maison, ce que l’on peut rapprocher du stéréotype de la femme dite hystérique. Il s’agit d’un texte parodique, répandu au XVIIe siècle et caractéristique du style de Scarron. Il n’est par conséquent pas étonnant que les protagonistes soient ridiculisés. Bien loin d’un quelconque renversement du genre, la lecture diachronique du mythe de la gigantomachie paraît le rattacher à un rapport originellement genré, tel que nous avions pu le lire à travers les textes antiques.
Le parcours qui a été le nôtre à travers le mythe de la gigantomachie nous a conduit à observer une approche genrée de l’affrontement entre les dieux et les Géants. S’agit-il de penser que le mythe est intrinsèquement, voire essentiellement genré ? Il est en tout cas le produit culturel des sociétés patriarcales dans lequel il évolue, qu’elles soient antiques, médiévales ou encore modernes, si bien qu’il s’en fait le reflet, comme le manifestent d’ailleurs de nombreux autres mythes ou récits issus de la culture gréco-romaine, comme le rapt de Proserpine, vouée à l’enlèvement et à la soumission, par exemple. En ce sens, les mythes nous informent sur le mode de pensée des sociétés qui les racontent.
Adrien Bresson et Blandine Demotz
Dans la même chronique


Dernières chroniques