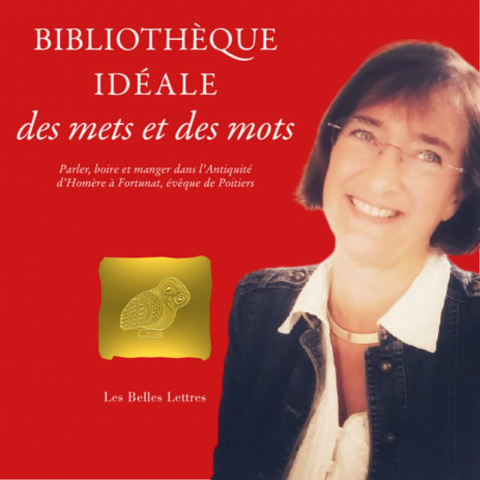
À l’occasion de la parution de la Bibliothèque idéale des mets et des mots aux éditions Les Belles Lettres, Catherine Schneider nous fait l’honneur d’un entretien exclusif pour nous raconter les propos et pratiques de table des Anciens.
La Vie des Classiques : Comment vous présenter ?
Catherine Schneider : En quelques mots, comme sur la quatrième de couverture de ma Bibliothèque idéale : je suis agrégée de grammaire, docteur ès lettres et maître de conférences à l’université de Strasbourg, où j’enseigne le latin depuis plus de vingt ans. Et, puisqu’il s’agit d’un entretien gourmand, j’ajouterais que j’ai toujours eu un goût égal, et prononcé, pour les mots et les mets, ma famille et mes amis le savent !
L.V.D.C. : Quelle a été votre formation intellectuelle ?
C.S. : J’ai eu la chance d’entrer et de faire toute ma scolarité dans un établissement qui perpétuait la tradition humaniste. J’y ai donc débuté très tôt l’apprentissage des langues anciennes, le latin en classe de sixième, puis le grec en classe de quatrième. J’avais la fibre littéraire, tout cela allait presque de soi pour l’élève que j’étais à l’époque. Après le baccalauréat de lettres, j’ai suivi la formation rigoureuse – dans tous les sens du terme – des classes préparatoires. J’ai continué par des études de lettres classiques à l’Université de Strasbourg, accompagnées d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire ancienne en magistère des sciences de l’Antiquité. J'ai donc suivi le parcours traditionnel d’un enseignant-chercheur de lettres en France, avec ses divers rites de passage initiatiques.
L.V.D.C. : Quel a été le premier texte latin et grec que vous ayez lu ?
C.S. : Petite fille, j’adorais les contes de fées ; des contes de fées, je suis passée à la mythologie antique, grecque, latine, égyptienne – mais pas seulement – que je lisais dans la merveilleuse collection des « Contes et légendes » de tous les pays, publiée chez Fernand Nathan, vous savez, cette jolie collection au cartonnage blanc et or, avec ses belles illustrations en couleurs, et si joliment écrits ! On les trouve encore chez les bouquinistes. Et c’est ainsi que, de la mythologie, j’en suis venue, par la guerre de Troie, à l’Iliade et à l’Odyssée d’Homère, que j’ai lue vers l’âge de onze ans, dans la traduction de Victor Bérard, l’un des tout premiers volumes de la collection Budé, repris en Folio Classique ; cela me paraît un peu fou à présent, mais il faut croire que j’étais vraiment une dévoreuse de livres ! J’ai toujours cet exemplaire dans ma bibliothèque, avec son paysage méditerranéen bleuté en couverture, comme une invitation au voyage. Je voulais alors devenir archéologue, pour découvrir Troie évidemment – quelle cruelle déception, quand j’ai appris que c’était chose faite ! Donc, à défaut d’être archéologue, me voici latiniste.
L.V.D.C. : Quel souvenir en gardez-vous ?
C.S. : Je tremblais pour Télémaque, j’étais captivée par les aventures d’Ulysse avec le Cyclope, Circé, les Sirènes, je pleurais à la mort de son vieux chien retrouvant son maître, j’adorais l’épreuve de l’arc et je dois dire que je jubilais à la lecture du massacre des prétendants, qui me paraissait bien mérité pour certains, surtout l’infâme Antinoos ! Les enfants aiment les histoires sanglantes, je l’ai souvent observé dans mes classes de collège, quand j’y enseignais...
Il y avait aussi la fameuse cicatrice qu’Ulysse avait reçue à la cuisse, d’un sanglier, et que sa nourrice Euryclée, une petite vieille « toute cassée, sans forces », reconnaissait quand elle lui lavait les pieds, et puis ce que j’appelais le « lit-arbre » de Pénélope et Ulysse, construit de ses mains dans un énorme et solide tronc d’olivier ! Et toutes ces merveilleuses épithètes homériques, un peu mystérieuses, mais si faciles à retenir ! Tout un univers de légendes : le divin Ulysse, le blond Ménélas, Achille aux pieds rapides et Agamemnon, protecteur de son peuple, et puis Hélène aux belles boucles ! Et les divinités ! Ah, l’Aurore aux doigts de rose, Héra, la déesse aux bras blancs, et puis Athéna, la déesse aux yeux pers, le terrible Poséidon, ébranleur de la terre et Zeus, l’assembleur de nuées, qui disait, quand il grondait sa fille, Athéna : « « Quel mot s’est échappé de l’enclos de tes dents, ma fille ? » Ce n’est évidemment pas un hasard si ces textes figurent au début de cette anthologie : ce sont des textes fondateurs pour la culture occidentale, comme pour moi.
L.V.D.C. : Et le premier texte latin ou grec que vous avez traduit ?
C.S. : J’adorerais vous répondre qu’il s’agit du premier vers, Arma virumque cano..., de l’Énéide de Virgile, une œuvre sublime, mais tel n’est pas le cas. J’ai retrouvé récemment, à la faveur d’un déménagement, mon manuel de latin de sixième : c’était en fait le manuel d’Ørberg ! Je n’en savais rien, à l’époque, mais c’était une fabuleuse méthode d’apprentissage du latin, à la façon d’une langue vivante, encore utilisée par certains, de nos jours. Donc, la première phrase de latin dont je me souvienne, allez savoir pourquoi d’ailleurs, car ce n’est pas la première du manuel, c’est Sicilia insula est. C’est ma petite phrase culte d’apprentissage, vous savez, comme le célèbre My taylor is rich dans l’Assimil d’anglais !
L.V.D.C. : Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre parcours ?
C.S. : À dire vrai, plus j’y pense, et plus je me dis que les figures qui ont finalement déterminé mon avenir ont été celles qui m’ont guidée à mon entrée au collège : le proviseur, d’abord, un latiniste lui-même, qui avait bien saisi mon goût pour les lettres et pour l’Antiquité en particulier, et qui m’avait inscrite d’autorité en classe de latin. C’était la première brique de tout un édifice qui s’est construit au fil des ans. Et puis, surtout, les deux premières professeures que j’ai eues, en sixième et en cinquième : ce sont elles qui m’ont propulsée dans la voie du latin ! Il y a vraiment dans l’Éducation nationale de bonnes fées qui se penchent sur le berceau de leurs élèves, on ne le dira jamais assez...
L.V.D.C. : Vous publiez, aux Belles Lettres, la Bibliothèque idéale des mets et des mots : comment vous en est venue l’idée ?
C.S. : D’une longue fréquentation avec un texte, en particulier, sur lequel j’ai beaucoup travaillé et qui m’a accompagnée sous diverses formes tout au long de mes années d’études, d’enseignement, et de recherche : le Satyricon de Pétrone, un auteur de génie qui jongle avec tous les codes, et son célébrissime Festin de Trimalcion, l’un des classiques antiques de « la grande bouffe », une satire féroce et cocasse du milieu des parvenus.
C’est un festin qui se veut somptueux, mais qui tourne à la farce, et dont on peut faire mille lectures ; j’en ajoute une, plus personnelle, car j’y vois aussi, pour ma part, en plus de tout le reste, une sorte de « livre des mauvaises manières », un anti-guide des convenances. Les convives y font et y disent tout ce qui ne se fait pas et ne se dit pas à table : ça se coupe la parole à tout va, ça crie et ça hurle, ça pleure, ça se saoule, ça s’insulte (« tête d’oignon frisé ! », « face de rat ! », « pif de truffe ! »), ça pète à table ! Et puis, on y parle affaires et économie, en rupture avec la parenthèse enchantée que devrait en principe former tout banquet. On y parle même politique et religion, de tous ces sujets qui fâchent et qu’il est de bon ton d’éviter, de nos jours encore, et qu’il était déjà de bon ton d’éviter, dans l’Antiquité, comme le disent clairement Pline le Jeune ou Plutarque. C’est ce triangle qui se dessinait dans mon esprit entre Pétrone, Plutarque et nos guides de savoir-vivre modernes qui m’a plus précisément amenée à concevoir cette anthologie.
Tout cela nous amène d’ailleurs à réfléchir sur les us et coutumes du passé, certes, mais aussi sur les nôtres... Ce ne sont pas les Anciens qui sont modernes, comme on aurait tendance à le dire, ou à vouloir le penser ; c’est plutôt, je pense, que la psychologie humaine n’a guère évolué depuis deux millénaires et que les Modernes, en termes d’affectivité notamment, ne sont pas aussi modernes qu’ils le croient : on peut donc lire les œuvres antiques, et s’y retrouver sans peine. Elles nous parlent ! Les Anciens nous tendent des miroirs où nous regarder, nous-mêmes.
L.V.D.C. : Comment avez-vous procédé pour regrouper et présenter ces textes si variés et si éloignés dans l’espace et le temps ?
C.S. : En lisant et en relisant, en annotant, en sélectionnant, en travaillant tard le soir à la lueur de la lampe, tout comme Aulu-Gelle l’avait fait près de deux mille ans plus tôt, dans ses Nuits attiques ! Au fil des siècles, l’humanité a eu beau passer des tablettes au papyrus, du papyrus au parchemin, du parchemin au papier, puis à tous les supports numériques ultramodernes dont nous disposons aujourd’hui, quand je lis les Anciens, je me dis que nos mécanismes intellectuels sont décidément restés les mêmes ! Cette parenté avec les auteurs du passé est fascinante...
J’ai aussi voulu faire de cette anthologie un festin, avec ses plats nobles (Homère, le Banquet de Platon, le banquet des Septante), ses codes de savoir-vivre édictés par Pline le Jeune, les Propos de table de Plutarque ou encore Clément d’Alexandrie, ses amuse-gueule et ses mignardises, comme les épigrammes de Martial, tous les petits vers charmants du gourmand évêque de Poitiers, Fortunat. On peut même y jouer aux devinettes avec Symphosius, dans la merveilleuse traduction en vers français de Corpet que j’ai découverte avec ravissement il y a quelques années. Et puis il y a aussi du sucré et du salé, du piquant et de l’amer : de l’amour et du sexe, avec Ovide, Apulée, ou Aristénète ; du vin, des rires et des chansons, avec les joyeux drilles de Plaute, Nonnos et tous les fameux buveurs d’anthologie ; du piquant, avec Lucien, du magique et du fabuleux avec Philostrate et Grégoire le Grand, mais aussi du tragique, avec Sénèque, ou des larmes avec les miséreux d’Alciphron. Et encore du politique et du diplomatique avec les chefs d’État et les grands de l’histoire (la reine Didon, les perses Cyrus et Cambyse, Alexandre le Grand, Mécène ou Caligula, et même Attila, roi des Huns !), et puis du sérieux, du mystique, de l’ascétique. Les mille et un ingrédients du grand festin de la vie, en somme ! J’aimerais que le lecteur se régale autant que je me suis moi-même régalée à la lecture de ces textes.
L.V.D.C. : De nombreux auteurs antiques, tant du côté grec que chez les Romains, ont écrit des œuvres mettant en scène des convives autour d’un banquet et prenant tour à tour la parole, allant de l’échange familier au discours philosophique. Était-ce un genre littéraire à proprement parler dans l’Antiquité ?
C.S. : Oui, on dîne beaucoup dans les textes antiques, et l’on y parle beaucoup aussi, mais on ne sait pas toujours ce qui se dit à table ! En tout cas, les auteurs anciens ne nous le rapportent pas toujours et parfois, on aimerait vraiment le savoir... Mais vous avez raison, en effet, on peut dire que le banquet est très tôt devenu un genre littéraire en soi, initié par les banquets socratiques de Platon et Xénophon, et même « formalisé » comme tel par le rhéteur Hermogène de Tarse au second siècle de notre ère. C’est un genre qui est bien représenté par la suite, tant chez les Grecs que chez les Romains, avec les banquets de savants qui sont comme des livres « d’érudition conviviale », des encyclopédies à destination de l’honnête homme ; c’est Plutarque et ses Propos de table ou son Banquet des sept sages, ce sont les Nuits attiques d’Aulu-Gelle ou les Deipnosophistes d’Athénée, ou encore les Saturnales de Macrobe, sans compter la veine satirique ou parodique. Elle est très tôt illustrée par le « repas ridicule » de Nasidiénus dans les Satires d’Horace, le Festin de Trimalcion dans le « roman » de Pétrone, ou encore Le Banquet ou les Lapithes de Lucien de Samosate, et même le Banquet ou les Césars, de l’empereur Julien, que je n’ai pas retenu dans mon anthologie. Comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts !
L.V.D.C. : Le titre de votre ouvrage contient une belle paronomase, rapprochant les plats et les propos de table : mets et mots, sont-ce là les deux composantes majeures du banquet antique ?
C.S. : Le titre se veut un hommage au merveilleux ouvrage de Michel Jeanneret, Des Mets et des mots. Banquets et propos de table à la Renaissance, publié à Paris 1987 aux éditions José Corti. Mais, pour en revenir à votre question, oui, mets et mots forment deux des principaux ingrédients de tout repas : les mets offerts aux convives peuvent être simples ou raffinés, peu importe en définitive ; le plus important, ce sont les mots qui en sont comme le nécessaire et précieux assaisonnement... Encore faut-il y ajouter du « liant », comme on dirait en cuisine, ce précieux lien, qui fait que « la mayonnaise va prendre », ou non, entre les convives.
C’est que pour réussir un festin, ou tout autre repas, d’ailleurs, il ne suffit pas de boire et de manger, encore faut-il savoir y manger, et surtout savoir y manger ensemble, savoir par exemple écouter et parler tout en mangeant et en buvant. Le repas est chez les Anciens un espace d’échange et de partage. Tel est d’ailleurs le sens premier du mot convivium en latin, et son sens profond : il est ici question de savoir-vivre et de « vivre ensemble », faute de quoi le banquet peut vite tourner au vinaigre – et c’est d’ailleurs bien souvent aussi le cas dans les récits antiques ! Il y en a de très sanglants, et ce n’est pas le sang de la viande animale qui coule, c’est bien celui de la chair humaine !
L.V.D.C. : Dans votre Bibliothèque idéale, vous consacrez une bonne place à la littérature dite « chrétienne », pourquoi ce choix qui semblerait paradoxal ?
C.S. : Si vous le percevez comme paradoxal, c’est peut-être que vous viennent d’abord à l’esprit les ascètes et les abstinents, la diète monastique, le jeûne ou le carême, le maigre par opposition au gras. Il est vrai que la gourmandise et tout ce qui l’accompagne est l’un des sept péchés capitaux et qu’elle est impitoyablement traquée dans les communautés monastiques. Cela nous vaut d’ailleurs un épisode savoureux, qui se situe au monastère de Condat, fondé vers 440 sur le site de la future ville de Saint Claude. Pour en débusquer des moines gloutons, qui bâfrent littéralement à la suite d’abondantes récoltes, l’Abbé Lupicin prétexte une sorte d’indigestion et demande à se nourrir « un temps d’herbes amères pour mieux digérer les aliments », puis il leur fait servir plusieurs jours de suite une bouillie de farine d’orge non tamisée, sans sel ni huile, la « bouillie de l’épreuve », comme il est dit – et c’est ainsi que les gloutons finissent par prendre nuitamment la fuite, soutanes au vent...
Pourtant des ascètes, il y en a tout autant du côté des païens, et depuis fort longtemps d’ailleurs – songez à Pythagore ou quelques siècles plus tard au néoplatonicien Porphyre qui prêche, lui aussi, le végétarisme dans son traité sur l’abstinence. Il y passe longuement en revue les diverses communautés qui, jusqu’à lui, auraient proscrit toute alimentation carnée de leur régime : Spartiates, Égyptiens, Esséniens, Syriens, Perses, Crétois et jusqu’aux Gymnosophistes en Inde.
À l’inverse il y a aussi des chrétiens, et même des religieux, très épris de bonne chère – voyez le gourmand Fortunat, évêque de Poitiers ! Fromage et lait, œufs, légumes, montagnes de viandes, châtaignes, prunes, fruits, tout le ravit et l’enchante, et il fait honneur à tous les plats. Chez l’un de ses hôtes, il s’extasie sur de grands tréteaux, chargés de mets abondants, et sur un plateau garni, « rebondi comme une colline » ; on lui sert des fruits de Perse – des pêches ! – puis une farandole de plats, dont il ne se lasse pas de manger et voilà que soudain son ventre gonfle et se tend, comme s’il allait accoucher, nous dit-il ! Formidable indigestion... Mais c’est un fabuleux convive, plein de tact et d’élégance, un merveilleux poète, qui trousse les vers avec une virtuosité sans pareille et chante sa reconnaissance en envolées lyriques : « Verdoyez pendant de longues générations ! », « Envolez-vous victorieuse au ciel et au-dessus des astres ! », clame-t-il à ses bienfaitrices, la reine moniale Radegonde et Agnès, Abbesse de Sainte-Croix.
L.V.D.C. : Il y aurait donc une continuité via le banquet ?
C.S. : Entre païens et chrétiens ? Oui, bien sûr, ne serait-ce que dans certains codes de bienséance, ceux, par exemple, que préconise Clément d’Alexandrie dans son œuvre intitulée Le Pédagogue, une notion héritée du monde grec et païen. Le pédagogue y était à l’origine un simple serviteur chargé de conduire l’enfant de la maison à l’école ; au fil des siècles, il est devenu une sorte de « tuteur » ou de « gouverneur » chargé de lui apprendre à bien se conduire en société. Clément y prône par exemple les règles de convenance qui interdisent tout laisser-aller à table et toute manifestation physique indésirable, comme les rots, les crachats, les mouchures, les éternuements. Vous voyez ? Rien de tout cela n’a changé ; ce sont toujours les mêmes règles qui prévalent, celles que l’on essaye d’inculquer aux enfants, dès leur plus jeune âge : « Tiens-toi droit ! », « Ne mets pas les coudes sur la table ! », « Ne parle pas la bouche pleine ! » On y préconise aussi les conversations de bon ton : ne parler ni trop fort, ni trop bas, sans monopoliser la parole, et toujours à bon escient. C’est tout l’idéal de l’ancienne société aristocratique grecque qui s’est ainsi transmise aux chrétiens ; ils étaient d’ailleurs eux-mêmes issus de ces milieux-là, pour certains, voire pour la plupart d’entre eux. Rien de plus naturel, donc, que de les voir perpétuer l’éducation qu’ils avaient reçue, même transfigurée.
L.V.D.C. : Certains textes sont de délicieuses curiosités : pourriez-vous nous parler du Banquet des dix vierges ?
C.S. : Ah oui, Méthode d’Olympe ! C’est l’un des textes que j’ai découverts au fil de mes lectures, comme d’ailleurs, dans un tout autre registre, celui de Priscos de Pannium sur son ambassade chez Attila – j’aime toujours découvrir des textes que je ne connais pas ! –, mais revenons-en à Méthode d’Olympe, dont on ne sait presque rien. La tradition en fait un évêque qui aurait eu charge d’âmes quelque part en Asie Mineure, peut-être dans la ville d’Olympe, et y serait peut-être mort en martyr à l’époque des dernières grandes persécutions. La plupart de ses œuvres ne nous sont plus connues que par des traductions en vieux-slave, et elles ont d’ailleurs exercé une influence profonde sur la pensée de l’Église russe byzantine, mais il nous reste tout de même, intégralement conservé en grec, son Banquet imité du Banquet de Platon, mais de teneur toute différente.
Quelque part en Orient, dans le jardin de Vertu, un jardin paradisiaque qui est une réplique du jardin d’Eden, dix vierges invitées par Vertu en personne se réunissent pour souper ensemble : Marcelle et Théophila, Thalie, Théopatra et Thallousa, Agathe, Procilla et Thècle, Tysiane enfin, et Domnine. Elles y dissertent tour à tour sagement sur la chasteté sous toutes ses formes, en contrepoint aux personnages de Platon, qui dissertaient sur l’Éros profane et païen. On y parle de péché, de virginité et de mariage, et chacune apporte, comme il se doit, son écot à la conversation : Agathe, par exemple, y parle de la parabole des vierges sages et des vierges folles, Procilla du Cantique des cantiques, Thècle évoque les dangers de l’astrologie et Domnine y décrypte la symbolique des arbres. Le symbolisme poétique y est puissant et l’œuvre est en quelque sorte un manuel de doctrine chrétienne, et plus encore...
L.V.D.C. : Et les dîners sadiques de Sénèque ?
C.S. : Cette fois, on verse dans le « gore », comme je le dis parfois à mes étudiants ! Les dîners, dans l’œuvre de Sénèque, sont rarement, comment dire... iréniques ? Je songe bien entendu au festin cannibale de Thyeste. Atrée s’y venge atrocement de son frère, en poignardant, cuisinant et servant lui-même ses enfants à leur propre père qui, sans le savoir, s’en régale joyeusement. Au moment où Thyeste repu demande à partager la joie de ce festin royal avec ses fils, Atrée lui fait cette sinistre réponse « Crois-le, tes fils sont là », lui lance à la face leurs têtes et leurs mains, révélant l’atroce vérité dans une jubilation sadique : « Je les ai poignardés, ... découpés, / mis en menus morceaux dont les uns ont bouilli / dans un chaudron d’airain, les autres dégraissé / à petit feu, quand j’ai tranché membres et muscles / ils vivaient, en voyant, piquées sur des brochettes, / mugir leurs chairs, moi-même ai attisé les flammes / de ma main ! » On lit un récit du même genre dans son traité Sur la colère, avec la figure d’Harpage, à qui le roi des Perses fait manger ses propres fils. Quand il lui demande à l’issue du festin ce qu’il pense de sa réception, le malheureux n’a d’autre choix que de lui répondre : « Chez un roi tout repas est agréable. »
L.V.D.C. : Pour finir sur une note de fantaisie : si vous organisiez un banquet, quels personnages antiques (et renaissants !) inviteriez-vous autour de votre table, et pourquoi ?
C.S. : Eh bien, en voilà un petit jeu amusant ! Et que l’on peut varier à l’infini, avec des dîners gais ou solennels, intelligents ou ennuyeux, et même mortels, avec un soupçon de cigüe et quelques champignons bien choisis. Si je devais organiser un banquet, ce serait d’abord par curiosité, pour y rencontrer et converser avec tous ceux que j’ai lus, et que j’ai aimés, autour d’un porcus Troianus cuisiné par Dédale, le chef de Trimalcion, ce fameux « porc à la Troyenne » d’où s’échappent des grives vivantes et qui a tant inspiré la Renaissance. Il serait bien entendu arrosé de Falerne opimien, servi par Ganymède le bel échanson des dieux – on se croirait dans une Trimalcionade ! J’y inviterais, sans ordre de préséance, Plaute pour sa fantaisie et son inventivité débridée, l’intelligent et affectueux Plutarque, le sensuel et gourmand Fortunat, le piquant Martial et l’énigmatique Symphosius, Didon sans Énée, pour éviter les drames, Frère Jean des Entommeures, Dom Pérignon – le bénédictin avec sa bouteille –, Alexandre Dumas pour son Grand Dictionnaire de cuisine, et tous ses romans. « À sept, c’est un repas, à neuf le brouhaha », dit l’adage antique, mais j’y ajoute malgré tout un dixième convive, Curnonsky, le « Prince des gastronomes », pour son grand œuvre Cuisine et Vins de France, son humour et tous ses écrits – Curnonsky était latiniste, alors... « pourquoi pas » ? ;-)
La Bibliothèque idéale des mets et des mots est à retrouver sur le site des Belles Lettres et en librairie !
Dans la même chronique

Entretien apocalyptique avec Jean-Louis Poirier et Hubert Le Gall

Entretien tragique avec Christine Mauduit
Dernières chroniques

