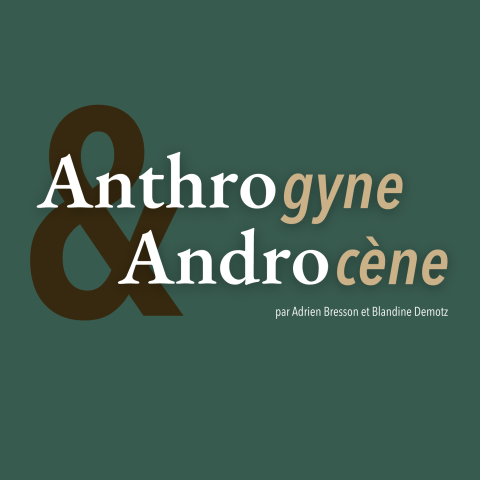
Le grec ancien a deux mots, bien distincts, pour distinguer l'être humain (anthropos) et l'homme, conçu comme être masculin (andros). La femme (gunè) est donc un anthropos au même titre que l'andros. Pour autant, les civilisations anciennes, dans leurs mythes notamment, ne manquent pas de mettre en scène des entités détachées de tout genre, ou au contraire aux genres pluriels, parfois androgynes, ou au-delà. Sont-elles alors à percevoir comme anthrogynes, dépassant le stade de la masculinité et faisant route vers l'humain, au sein même de sociétés androcènes, et donc patriarcales ? En étudiant les rapports de genre parmi les textes et les représentations anciennes, de l'Antiquité à sa réception contemporaine, Adrien Bresson et Blandine Demotz invitent à repenser les représentations stéréotypées du masculin, du féminin et du neutre.
Le propre des éléments naturels mentionnés dans les récits gigantomachiques est d’avoir une utilité avant tout matérielle : ils sont mis à contribution et sont à ce titre à la portée des acteurs du mythe qui s’en servent afin de mener leurs assauts, comme il est possible de le constater à travers un extrait de la Gigantomachie de Claudien :
Hic rotat Haemonium praeduris uiribus Oeten,
hic iuga conixus manibus Pangaea coruscat,
hunc armat glacialis Athos, hoc Ossa mouente
tollitur […].
L’un fait tourner, avec vigueur et force, l’Oeta hémonien ; par l’effort de ses mains, l’autre brandit le sommet du Pangée ; l’Athos glacé arme cet autre, un tel ébranle et soulève l’Ossa, […].
Claudien, Gigantomachie, v. 66-69
éd. et trad. Jean-Louis Charlet,
Paris, Les Belles Lettres, CUF, 2018.
Plusieurs éléments naturels sont cités et listés dans cet extrait : l’Oeta, le Pangée, l’Athos, l’Ossa. Il s’agit de monts à la merci des Géants qui les arrachent et s’en servent comme armes. En conséquence, ces éléments naturels sont dans une position de soumission par rapport aux Géants qui sont en mesure de s’en emparer à leur guise. La position de domination des Géants est matérialisée, à l’égard des éléments, par une attitude genrée, marquée par des termes comme uiribus, les « forces », formées sur le mot uir, « l’homme ». Le rapport de domination qui existe passe donc par le fait que les Géants sont rattachés au genre masculin. Une emphase particulière est mise sur la soumission des éléments terrestres par rapport aux Géants, comme l’illustrent les v. 62-64 de la Gigantomachie de Claudien, dans lesquels les protagonistes monstrueux ne s’arment pas seulement des éléments terrestres mais les bouleversent, renversant l’ordre établi pour parvenir à leurs fins :
Discrimina rerum
miscet turba potens : nunc insula deserit aequor,
nunc scopuli latuere mari.
La troupe puissante confond les limites des éléments : tantôt une île abandonne les flots, tantôt la mer cache la roche.
Claudien, Gigantomachie, v. 62-64
éd. et trad. Jean-Louis Charlet,
Paris, Les Belles Lettres, CUF, 2018.
Les actions produites par les Géants sur les éléments sont à l’origine d’adynata, phénomènes inconcevables et irréalistes. Ce qui a lieu est à la fois impossible et impensable. Des faits contraires la logique même de l’existence se produisent, comme le fait qu’insula deserit aequor (« une île abandonne les flots ») : le propre d’une île est d’être baignée d’eau. Si tel n’est plus le cas, sa nature est changée. Ainsi, la domination masculine et virile des Géants est telle que les éléments naturels ne sont pas seulement bouleversés, ils sont modifiés dans leur nature même afin de correspondre aux souhaits et aux gestes des Géants. La soumission des éléments est à tel point totale que s’interroger sur leur genre est pertinent. Sont-ils considérés comme étant d’un genre neutre, non énoncé, justifiant qu’ils soient à la merci de tout individu, ou bien seraient-ils plutôt perçus de la manière dont est parfois traité et soumis le féminin par les figures masculines ? Le fait que les éléments soient soumis et dominés explique certainement, par contraste, la force qui est rattachée à certains protagonistes féminins du mythe, bien loin de tomber dans le stéréotype d’un féminin subalterne, comme nous le verrons dans de prochaines chroniques.
Adrien Bresson et Blandine Demotz
Dans la même chronique


Dernières chroniques

La Note Antique – La notation musicale
