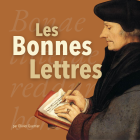Cette chronique expose les principales étapes de l’élaboration d’une édition critique dans la Collection Budé, depuis le choix du texte édité jusqu’à la mise au point définitive.
Michel Patillon cultivait davantage le savoir que le faire savoir. Il a construit dans la plus grande discrétion, sans demander ni recevoir la moindre distinction, une œuvre considérable. Il a longtemps attendu avant d’obtenir un poste de directeur de recherches au CNRS et là, à la tête de la section Grecque de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, il a laissé le souvenir à la fois d'un grand chercheur et d’un homme empathique. L’une de ses collègues de l’époque, Anne Boud’hors, écrit : « je garde le souvenir d'un immense savant doublé d'un homme étonnant d'énergie, de volonté et, ce qui est peut-être moins bien connu, d'attention aux autres. Les années passées à la section Grecque sous sa direction restent marquées par cette façon qu'il avait, discrète et efficace, de s'intéresser à ses collaborateurs ».
Discrétion ne veut pas dire effacement. Michel Patillon avait une personnalité très forte, et présentait des singularités qui ont contribué à l’importance de sa production scientifique[1]. Ce fut d’abord un grand helléniste, comme on n’en fait plus, avec un sens instinctif de la langue, qui l’a rendu très créatif en matière de critique textuelle. Cette approche instinctive, il la devait à des années d’enseignement du Grec en lycée, mais aussi et surtout à une circonstance de l’histoire. Il était né en 1932 dans une famille modeste de Loire-Atlantique, à Saint-Père en Retz, près de Pornic. Après le débarquement des Alliés, le 6 juin 1944, la Wehrmacht organisa sa résistance à leur avancée dans ce que l’on a appelé « la poche de Saint-Nazaire », qui ne céda qu’un an après. Pornic, par exemple, ne fut libérée que le 11 mai 1945, soit trois jours après la capitulation allemande. C’est ainsi que le petit Michel apprit le grec de manière intensive, par des cours particuliers, auprès d’un vieux prêtre entièrement disponible, dans un de ces moments où l’Histoire paraît suspendue.
La suite paraissait écrite : Michel serait prêtre. Il a fréquenté le « juvénat » (alias « petit séminaire ») mais ses rapports avec la religion ont vite été marqués par la critique, au sens strict de ce terme, qui implique une séparation, une distance et une analyse objective de ce que l’on a quitté, définitivement ou non. Comment pouvait-il faire siennes les dérives catholiques si présentes à l’époque comme la superstition, le fanatisme et son corollaire, l’esprit de soumission, ou l’hypocrisie en matière sexuelle ? Mais quelle que soit sa forme terrestre, belle ou laide, une religion est d’abord une question, et Michel Patillon a transféré cette question dans l’univers culturel de l’hellénisme, un contexte où la métaphysique s’est constituée comme discipline et la philosophie s’est ilustrée par sa richesse et sa diversité. Michel Patillon a consacré toute son énergie à des textes de rhétorique, discipline méprisée et négligée à l’époque, mais il a toujours abordé cette discipline avec le regard du philosophe. Il n’est pas indifférent que le premier auteur dont il a procuré des éditions critiques ait été Porphyre, philosophe néo-platonicien des 3e-4e s. ap. J.-C., et que parmi les derniers traités de rhétorique qu’il a travaillés figurent deux opus de Syrianus, autre philosophe néo-platonicien (5e s. ap. J.-C.). Je m’honore d’avoir été son ami, mais un autre de ses amis ne fut autre que Luc Brisson, l’un des meilleurs spécialistes actuels de l’œuvre de Platon.
Une deuxième rencontre essentielle, après le Grec, fut celle de la linguistique. L’essor de cette discipline dans les années soixante-dix fut pour lui l’occasion d’une réflexion comparatiste entre les théories structuralistes les plus avancées et l’héritage de la linguistique ancienne, dont le principal vecteur fut la rhétorique, avec la grammaire, d’invention plus récente. Témoignent de ce très vif intérêt des ouvrages rédigés pour les étudiants en lettres[2] mais aussi et surtout sa thèse d’État dont le sous-titre est particulièrement éloquent : La théorie du discours chez Hermogène le Rhéteur. Essai sur les structures linguistiques de la rhétorique ancienne[3]. Pour se faire une idée de la fécondité de cette conjonction de la rhétorique ancienne et de la linguistique la plus moderne, il n’est que de lire ses analyses des mécanismes de l’allusion chez Hermogène le Rhéteur[4].
Un trait non moins essentiel de la personnalité de Michel Patillon est l’énergie, la capacité de travail. Aiguillonné sans doute par les attaques répétées du cancer, stimulé aussi par le sentiment de solitude, notamment après le décès de sa deuxième épouse, Jeannette, il a produit une quantité impressionnante d’éditions critiques, avec une exigence scientifique du plus haut niveau, internationalement reconnu. Il est impossible de rendre compte ici, sinon sous la forme d’une liste sèche du nom des auteurs édités (Aelius Théon, Anonyme Séguier, Aphthonios, Cassius Longin, Eustathe, Georges Monos d’Alexandrie, Hermogène, Longin, Marcellinus, Maxime, Porphyre, Ps.-Aelius Aristide, Ps.-Hermogène, Ps.-Sopatros, Sopatros, Rufus, Syrianus), de la richesse de cette production, qui ne comprend pas moins de vingt volumes, tous parus dans la prestigieuse collection Budé. Deux volumes supplémentaires, préparés avec sa collaboration, sont encore à paraître.
Dans cette œuvre monumentale se détachent ce qu’on peut appeler des chefs-d’œuvre philologiques, c’est-à-dire des éditions critiques qui renouvellent complètement la compréhension du texte édité. Donnons seulement deux exemples parmi beaucoup d’autres.
Le premier est l’édition des Progymnasmata d’Aelius Théon (1997). Il existe de ce texte grec une traduction en arménien, datable du 6e s. ap. J.-C. Mais cette traduction était telle quelle quasiment incompréhensible, parce qu’elle était conçue comme une transposition verbatim depuis le grec. Michel Patillon, avec la collaboration d’arménologues expérimentés, Giancarlo Bolognesi et Agnès Ouzounian, a établi la correspondance la plus stricte possible entre le grec et l’arménien pour toutes les parties où le texte est conservé dans ces deux langues. Cette correspondance a permis une rétroversion de l’arménien au grec quand ce dernier faisait défaut. Grâce à l’informatique, M. Patillon a projeté en face de l’arménien tous les mots grecs dont l’équivalence avec cette langue avait été établie précédemment. Il a obtenu une sorte de trame pour la reconstitution du grec. Le papyrologue Jean-Luc Fournet a salué cette édition, dans la Revue des Études Grecques, comme un « événement philologique ». C’est d’autant plus vrai que le « nouveau texte », au sens où on peut le lire, depuis 1997, sous une forme qu’il avait perdue depuis 1500 ans, renouvelle considérablement notre vision de la pédagogie ancienne et dément en particulier les jugements mitigés d’Henri Marrou.
Un autre « geste » philologique d’imortance est la publication, de 2008 à 2014 du Corpus rhetoricum, à savoir d’un ensemble de traités regroupés en cycle de formation, dont l’importance dans l’histoire culturelle fut considérable à partir du 5e s. L’intérêt pour un texte isolé se double alors d’une prise de conscience de sa réception, c’est-à-dire de ses lectures et de ses usages.
La concentration, la puissance intellectuelle, chez Michel Patillon, ne voisinaient pas avec l’esprit de sérieux ou l’étroitesse d’esprit, oh que non. Adepte du naturisme, il avait beaucoup d’humour et régalait son cercle d’amis de fictions drôlatiques ancrées dans la vie campagnarde qu’il avait connue dans sa jeunesse dans le pays de Retz. Ses derniers mois ont été assombris par les terribles douleurs qu’il devait à une nouvelle attaque du cancer et qui n’ont guère été palliées par la médecine. Il a résisté à ces douleurs avec un courage lui aussi admirable.
Sa disparition laisse un vide, naturellement, mais son œuvre répond à l’exigence que fixait Thucydide : il s’agit sans conteste d’un κτῆμα ἐς ἀεί, un bien acquis pour toujours.
Pierre Chiron
[1] Voir L. Brisson & P. Chiron (éds), Rhetorica Philosophans. Mélanges offerts à Michel Patillon, Paris, Vrin (coll. Textes et Traditions, n°), 2010.
[2]Précis d’analyse littéraire, 2 vol., Nathan, 1974 ; 1977.
[3] Les Belles Lettres, 1988 (réimprimé en 2000).
[4] « Le De inventione du Pseudo-Hermogène », ANRW II 34. 3, 1997, p. 2064-2171.
Dans la même chronique

La cuisine de Guillaume Budé – XII. Règles et recommandations

La cuisine de Guillaume Budé – XI. Traduire, disent-ils…
Dernières chroniques