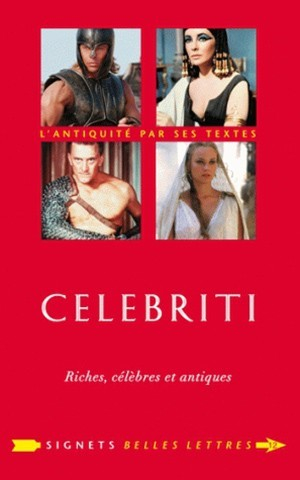
A l’occasion du festival de Cannes, La vie des Classiques vous offre un entretien avec Frédéric Beigbeder sur les stars de l’Antiquité issu du Signet Celebriti !
Comment avez-vous découvert que vous étiez devenu une célébrité ?
Il y a quelque chose de très mystérieux dans le fait que les gens décident un jour de parler de vous, parce que ce n’est aucunement contrôlé. La célébrité est un accident, du moins dans mon cas. Je ne comprends toujours pas pourquoi 99F a eu un tel succès. Ce n’est pas mon meilleur livre et je le considère plutôt comme un essai que comme un roman. Je fais du journalisme littéraire depuis près de vingt-cinq ans et dans mon cas, quand vous commencez à écrire des papiers, les gens s’habituent à votre nom, surtout si vous avez un patronyme bizarre. Ensuite arrivent les photos dans les journaux, la télévision. Et puis un jour, vous êtes en train de déjeuner, et Daniel Auteuil vient vous dire bonjour, alors que vous ne le connaissez pas. Je ne le savais pas, mais toutes les célébrités se saluent entre elles, qu’elles se connaissent ou non. Et ne pas se saluer relève du manque de savoir-vivre d’après les codes en vigueur dans cette aristocratie. On peut parler de Franc-maçonnerie de la notoriété.
La célébrité est généralement associée aux excès et aux dérives en tous genres, dans le sexe et les drogues. C’est une permanence depuis l’Antiquité.
Il ne faut pas croire que les fêtes données par les célébrités ressemblent toutes à l’orgie du Eyes Wide Shut de Kubrick. Dans le film, toutes les filles sont sublimes, les vêtements sont magnifiques, le cadre somptueux. Dans la réalité, les gens sont en slip et en chaussette. Cette association entre célébrité et décadence relève beaucoup de l’ordre du fantasme, d’une vision onirique. Les excès de ce point de vue ne sont pas l’apanage des célébrités, loin de là. Michel Houellebecq en parle fort bien dans ces romans, en décrivant ce qui pourrait aussi s’apparenter à des excès mais chez les classes moyennes, et alors cela devient pathétique. Pour le sado-masochisme, c’est un peu la même chose. J’adore le Histoire d’Ô de Pauline Réage, qui est un roman magnifique, mais la réalité est absolument risible. Il faut essayer d’imaginer Edward Stern, une authentique célébrité, en combinaison intégrale de latex. La réalité est d’une tristesse absolue, au mieux grotesque. Mais peut-être n’ai-je pas été invité dans les bonnes soirées. En même temps, je suis très pudique en raison de mon éducation bourgeoise.
La célébrité, le glamour sont un véritable motif littéraire aux États-Unis notamment, avec des auteurs comme Tom Wolfe, Jay McInerney ou Bret Easton Ellis. En France, on a l’impression que ce n’est pas un sujet suffisamment noble.
Le roman français s’est globalement éloigné du réalisme. J’essaye à ma manière d’évoquer ce que l’on pourrait appeler la « upper class », comme Lolita Pille. François Sagan aussi traitait de ses sujets. Elle évoque des cocktails dans des grands appartements parisiens, avec des femmes dépressives, amoureuses d’un homme qui ne les rappelle jamais. Je ne sais pas si cela correspond à votre idée du glamour. Les Américains sont un peu plus naïfs que nous : la célébrité les fascine comme au premier jour. Il y a des magazines comme Vanity Fair dont le fond de commerce est la vie des gens riches et connus, mais d’un point de vue littéraire. Ici, les mêmes personnes relèvent de la presse people. Voici, où je tiens une chronique, est peut-être un cas à part puisque plusieurs écrivains y écrivent des textes, souvent drôles et irrévérencieux, sous pseudonyme. Des auteurs comme Gilles Martin-Chauffier ou Marc Lambron ont écrit des romans qui évoquaient ces milieux de gens riches et célèbres mais qui s’ennuient. Il est vrai que sur ce motif, Bret Easton Ellis a une folie, une puissance d’écriture qui surpasse tout.
On a l’impression aujourd’hui d’une célébrité « au rabais », avec la promotion de people à la petite semaine par le biais des émissions de télé-réalité par exemple.
Je vois plutôt cela comme la formule de Marie-Antoinette qui répondait, alors qu’on lui disait que les Français avaient faim, « S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche. » Pour moi la télé-réalité est cette brioche que l’on donne aux personnes qui sont frustrées de s’imaginer une élite de trois cents personne confisquer la célébrité à son profit. Alors on leur donne un loft pour leur donner l’illusion que la célébrité est démocratique.
Peut-on être exclu du cercle des célébrités pour une raison ou une autre ?
Cela doit être une réalité, mais pour ma part, ce n’est pas grandeur et décadence. Certes, j’ai connu des échecs, une émission ou un livre qui n’ont pas marché. Mais la notoriété ne vous quitte pas véritablement, que vous soyez has-been ou non. Vous serez connu comme has-been, mais vous ferez toujours parti du cercle. Il y a une solution radicale dans ce cas, c’est ce qu’a fait Salinger. Disparaître totalement, au sommet de sa gloire, comme cela vous ne serez jamais has been, mais une énigme, celle d’un auteur mystérieux et misanthrope. Je crois que c’est Martin Amis qui dans un article sur Salinger a affirmé qu’il était le plus grand publicitaire de notre temps. On peut donc penser qu’il s’agit autant d’une stratégie que d’une infirmité ou d’une fatigue. Le refus du Goncourt par Julien Gracq pose le même type de problème. Gracq vivait en province, mais recevait volontiers beaucoup de visiteurs prestigieux.
Et comment devient-on un noctambule ? Pourquoi en fait-on un art de vivre ?
J’ai commencé à sortir de manière un peu précoce. Normalement, arrivé à un certain âge, on commence à se lasser. Là, j’ai 44 ans, et je continue à sortir. C’est un peu pathétique, mais la réalité est que mon travail ne consiste plus à me rendre dans un bureau depuis dix ans. Je travaille chez moi, où j’écris mes articles, mes livres, où je prépare mes émissions. Lorsque la nuit tombe, je n’ai vu personne de la journée et je n’ai qu’une envie, c’est de sortir et voir du monde. Ce soir par exemple, je suis disque-jockey chez Régine. Alors j’en ai fait un sujet, me semble-t-il plus fertile et digne d’intérêt que mes journées, même si dans mes derniers romans, L’égoïste romantique ou Un roman français j’évoque un peu plus le cadre dans lequel je travaille. Mais la nuit, on voit des jolies filles en état d’ébriété, des gens bien habillés qui sont spirituels, d’autres qui ne sont pas drôles du tout. Cela vient aussi peut-être de mon enfance, où j’ai des souvenirs de soirées que mon père organisait alors que j’avais huit ans, avec de très belles femmes qui sentaient bon. Il y clairement un côté féérique à la nuit, dont je trouve qu’elle embellit les personnes. J’aime aussi les romans de Fitzgerald parce que les personnages sont en smoking et lorsque quelqu’un déclare que « le bonheur n’existe pas », cela me touche davantage s’il est en costume que s’il est en jeans. On peut consacrer toute son existence à traiter des mondanités. Proust l’a fait, et Gide ne voulait pas le publier pas parce qu’il le trouvait snob. On reprochait à Truman Capote d’écrire sur Tiffany’s, puisque cela n’aurait aucune chance d’intéresser les gens qui vivaient au Kansas. Il a répondu que « même un lapon isolé sur sa banquise doit comprendre l’importance d’une visite chez Tiffany’s ». C’est une phrase qui me protège. Une soirée au Montana ou au Baron doit pouvoir intéresser un lapon isolé sur sa banquise.
Avez-vous des modèles de prédilection, littéraires ou non, sur ce monde de la nuit ?
Alain Pacadis m’a beaucoup inspiré, notamment dans sa manière d’interviewer les célébrités. Je fais des entretiens dans GQ. Il avait emprunté une façon d’interviewer, faite de connivence et d’insolence, à Truman Capote, comme alterner des flatteries et des familiarités, passer au tutoiement assez vite. Quand j’étais adolescent, dans les années 1980, je lisais des journaux gratuits comme Palace Magazine, qui relatait la vie du Palace, la boite de nuit légendaire de ces années là. Je crois que j’aimais me sentir exclu. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de l’exclusion et de l’arrogance dans la littérature. Aujourd’hui, on a encore tendance à croire qu’un écrivain doit être démagogue et plaire aux masses. Je ne crois pas que le rôle d’un écrivain soit d’être un individu normal, qui fasse sentir sa proximité avec son lecteur.
Précisément, le monde de la nuit et des célébrités est généralement raillé ou considéré avec condescendance par les intellectuels.
Mais Roland Barthes était un habitué du Palace ! Quelquefois l’université et les intellectuels ont tendance à s’éloigner de la véritable poésie. Regardez Jean-Jacques Schuhl, qui est un écrivain dont on reconnaît le talent exceptionnel. Dans son dernier roman, il ne parle que du Mathis Bar, de margaritas, du détail d’une robe, d’un fauteuil. Il y autant de poésie dans son monde que dans la description du monde rural. Lorsque j’ai découvert Antoine Blondin, cela a été une révélation pour moi : on avait enfin le droit de s’amuser, à Saint-Germain-des-Prés, de vivre une vie de patachon, et être écrivain. Mais Blondin n’est pas très estimé, pas plus que Boris Vian dans un autre style. Il y a sans doute un problème aussi dans le rapport à l’argent du monde intellectuel. Aux États-Unis, les auteurs que nous avons évoqués comme Ellis ou McInerney n’ont pas les faveurs de revues de références comme le New York Times Book Review. Ce sont des auteurs que l’on ne prend pas au sérieux. On a encore le catéchisme que, pour être un bon écrivain, il faut soi-même souffrir, avoir une vie sinistre, et faire aussi souffrir son lecteur, ce qu’explique très bien Philippe Sollers. Il y a quelque chose de sain dans le snobisme. Comprendre l’élite, en faire partie, la regarder évoluer, la décrire, cela constitue pour moi un moteur. Je crois que le snobisme qui consistait pour la jeunesse dorée d’Athènes à payer les sophistes non pas simplement parce qu’ils étaient les plus brillants mais parce que c’était une tendance a quelque chose de sain. Mais Il fut une époque où les intellectuels étaient de véritables figures populaires. Il y avait énormément de monde à l’enterrement de Jean-Paul Sartre par exemple. Je ne suis pas sûr qu’il y en ait autant à l’enterrement de Patrick Modiano. A celui de Robbe-Grillet, qui était une véritable star dans les années 1960, il y avait huit personnes.
Lorsque vous faites des chroniques dans des revues comme Voici, comment choisissez-vous votre sujet ?
Ce sont des sujets qui sont en phase avec l’actualité mais qui révèle aussi un certain nombre de vérités sur notre époque. Par exemple, ma dernière chronique portait sur une soirée télévisée, où vous aviez sur Arte une émission consacrée à Jan Karski avec Claude Lanzmann et sur une autre chaîne une émission intitulée Le Jeu de la mort. Il était très cohérent finalement de diffuser le témoignage d’un témoin du Ghetto de Varsovie, que personne ne veut croire sur le génocide des Juifs au moment où il essaye d’avertir le monde entier, en même temps qu’une sorte de fausse télé-réalité où des candidats sont encouragés à torturer des présumés cobaye. C’est la preuve d’une certaine manière que, même aujourd’hui encore, Karski n’a pas été entendu. La chronique nécessite une spontanéité, une réactivité, un peu comme les prédicateurs de Hyde Park, ou même comme Diogène, avec ce qu’il faut d’humour et de colère, en sachant que vous écrivez pour un support très populaire, sur un sujet qui doit être compréhensible par tous.
C’est quelque peu en contradiction avec cette aspiration à faire partie d’une élite.
Je ne crois pas. Le mot d’ordre de Jean Vilar était « l’élitisme pour tous » au TNP, non ? J’ai soutenu le Part Communiste à une élection présidentielle avec cette contradiction. J’aimais l’image de Roger Vaillant comme romancier communiste qui roule en jaguar, ou la phrase de Jacques Rigaud, cet écrivain d’inspiration dadaïste et mondain qui disait : « Chaque fois que je vois une Rolls, mon existence se prolonge de quinze minute », ce qui ne l’a pas empêché de se donner la mort à 31 ans.
Mourir jeune, c’est aussi une forme d’accès à l’immortalité et à la célébrité.
Je suis très attiré, curieusement, par beaucoup d’écrivains qui sont morts jeunes, quelles que soient les circonstances de leur mort. Vian est mort très jeune d’une maladie du cœur, Fitzgerald est mort à mon âge, à 44 ans. Mais je ne suis pas du tout comme Achille, et s’il faut mourir jeune pour passer à la postérité, j’y renonce le cœur léger. Le récent livre de Nicolas Rey pourrait par exemple porter le titre de Comment j’ai décidé de ne pas mourir jeune.
Vous êtes vous-même connus pour vos excès.
Je crois que l’on prête beaucoup d’importance à ce qui ne le mérite pas. Pour moi, prendre de la drogue est assez anecdotique. Il y eut des époques où la drogue ne faisait guère parler, c’était quelque chose de très marginal, et c’est la prohibition, l’interdiction, qui lui donne ce caractère sulfureux. Je sais fort bien que la drogue fait partie de la panoplie des people, mais il y a tout autant de drogués inconnus qu’il y a de célébrités qui ne se droguent pas. Globalement, comme la plupart des célébrités sont aussi des gens qui travaillent beaucoup, par la force des choses la drogue est assez incompatible avec leur mode de vie. Et puis la drogue pour faciliter la création, je n’y crois guère. Cela met dans un état où l’on devient paresseux, répétitif dans ce que l’on écrit ou ce que l’on dit. Lorsque vous écrivez après avoir pris de la drogue, vous dites des choses banales, et vous les répétez vingt fois. J’ai fait un recueil de nouvelles chez Gallimard en 1999, et la première nouvelle, que j’ai écrite sous ecstasy, est une suite de questions. Le MDMA est une molécule qui vous pousse à vous interroger manifestement. Mais globalement, même chez les grands écrivains drogués, ce qui est écrit spécifiquement sous l’effet de la drogue n’est pas ce qu’ils font de meilleur, à l’image de Williams Burroughs lorsqu’il écrit sous héroïne. Pour moi la meilleure drogue pour écrire, c’est le vin, comme tout ce qui peut désinhiber pour écrire est souhaitable. La drogue est un plaisir, et les plaisirs sont à la fois nécessaires et dangereux.
Comment fixez-vous alors vos limites dans les excès ?
D’abord parce que je suis un peu peureux. Et puis, comme je l’ai dit, j’ai une éducation très classique, catholique, culpabilisante. A partir d’une certaine heure, ce côté de la nuit étincelant et fascinant, comme dans les films de Wong Kar-Wai, finit par disparaître. J’ai vu beaucoup de gens autour de moi sombrer, c’est donc que je dois avoir un instinct de survie plus prononcé. Sur cette question des excès, quand nous avons fondé le Prix de Flore, ou alors quand des écrivains, qu’on a qualifié à l’époque de néo-naturalistes, comme Vincent Ravalec ou Virginie Despentes se sont mis à écrire de manière très réaliste, très trash, nous n’imaginions pas, à la lumière de tous ces textes de l’Antiquité, que nous avions deux mille ans de retard.
Dans la même chronique

Entretien avec Michel Casevitz et Aude Cohen-Skalli

Entretien moderne avec Giusto Traina
Dernières chroniques

Les Bonnes Lettres – Qu’est-ce que l’ « Humanisme civique » ?
