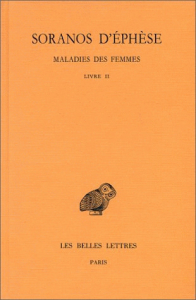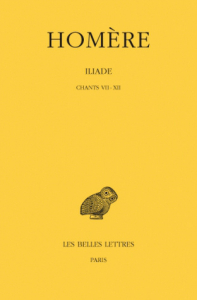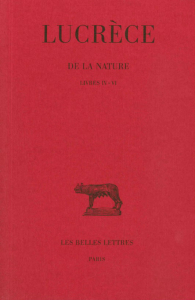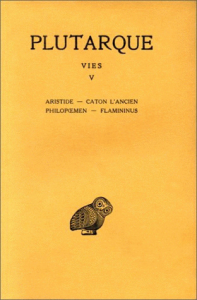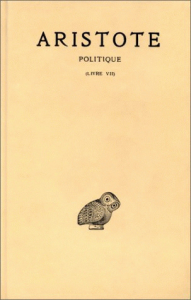Soranos d’Éphèse, Maladies des femmes, II, 7, texte établi et traduit par P. Burguière, D. Gourevitch et Y. Malinas, CUF.
Après avoir couché le nouveau-né emmailloté, il faut le laisser en repos et ne lui donner aucune nourriture pendant deux jours dans la plupart des cas : l’enfant est en effet encore, à tous les points de vue, perturbé par le traumatisme de la naissance, et d’ailleurs son corps tout entier reste plein de nourriture maternelle, qu’il doit d’abord digérer, pour en recevoir d’autre le moment venu – à moins pourtant que l’appétit n’ait fait son apparition avant ce laps de temps.
Après avoir respecté ce délai, il faut lui donner de la nourriture à lécher : ce ne doit pas être du beurre (car il est lourd et fait mal à l’estomac), ni de l’aurone mélangé à du beurre, ni même du cresson ou de la farine d’orge pétrie ; qu’on lui donne donc du miel modérément cuit. On badigeonnera doucement du doigt la bouche du nouveau-né, sur laquelle on fera couler quelques gouttes d’eau miellée tiède ; par ce moyen, on affine ce qu’a d’inerte et d’épais cette substance, on provoque l’éveil de l’appétit et on ouvre les voies de l’ingestion ; en rendant perméable et en nettoyant le passage des aliments, on prépare l’assimilation et on nourrit l’ensemble du corps.
Le lendemain de ces deux jours, après la toilette, il faut enfin nourrir l’enfant du lait d’une femme capable de l’allaiter convenablement ; en effet, jusqu’au troisième jour, le lait de la mère risque d’être mauvais ; il est épais, trop caséeux, par suite indigeste, inerte, inassimilable, produit par un corps qui a souffert, subi des troubles et une modification aussi considérable que celle qu’on observe après l’accouchement : amaigrissement, faiblesse, pâleur et forte perte de sang, le plus souvent fièvre. Pour toutes ces raisons, l’indication du lait maternel est aberrante jusqu’au moment où le corps de la mère aura retrouvé son équilibre.
Macrobe, Commentaire au songe de Scipion, I, 6, 71, texte établi et traduit par Mireille Armisen-Marchetti, CUF.
Sept heures après l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra, ou si, étant mort-né, son premier souffle a été son dernier ; car il n’est reconnu viable que lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pendant cet intervalle de temps ; à partir de ce point, il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on peut éprouver à tout autre âge. C’est au septième jour de sa naissance que se détache le reste du cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses yeux sont sensibles à l’action de la lumière, et après sept fois sept jours il regarde fixement les objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure. Sa première dentition commence à sept mois révolus ; et à la fin du quatorzième mois, il s’assied sans crainte de tomber. Le vingt-unième mois est à peine fini, que sa voix est articulée ; le vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant se tient debout avec assurance, et ses pas sont décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il éprouve un commencement de dégoût pour le lait de sa nourrice ; s’il use plus longtemps de ce liquide, ce n’est que par la force de l’habitude. À sept ans accomplis, ses premières dents sont remplacées par d’autres plus propres à la mastication d’aliments solides ; c’est à cet âge aussi que sa prononciation a toute sa perfection : et voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inventrice des sept voyelles, bien que ce nombre se réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas à l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. À la fin de la quatorzième année, la puberté se manifeste par la faculté génératrice chez l’homme, et par la menstruation chez la femme. Ces symptômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’époque de sa majorité, que les lois ont avancée de deux ans en faveur de la jeune fille, à cause de la précocité de son organisation.
Homère, Iliade, IX, 485-495, texte établi et traduit par Paul Mazon, CUF.
Et c’est moi qui ainsi t’ai fait ce que tu es, Achille pareil aux dieux, en t’aimant de tout mon cœur. Aussi bien tu ne voulais pas toi-même de la compagnie d’un autre, qu’il s’agît ou de se rendre à un festin ou de manger à la maison : il fallait alors que je te prisse sur mes genoux, pour te couper ta viande, t’en gaver, t’approcher le vin des lèvres. Et que de fois tu as trempé le devant de ma tunique, en le recrachant, ce vin ! Les enfants donnent bien du mal. Ah ! que, pour toi, j’ai souffert et pâti, songeant toujours que les dieux ne voulaient pas laisser venir au monde un enfant né de moi ! Et c’est toi alors, Achille pareil aux dieux, c’est toi dont je voulais faire le fils.
Lucrèce, De la nature, V, 224-235, texte établi et traduit par A. Ernout, CUF.
L’enfant ressemble au matelot qu’ont rejeté des flots cruels ; il gît à terre, nu, incapable de parole, dépourvu de tout ce qui aide à la vie, depuis le moment où la nature l’a jeté sur les rivages de la lumière, après l’avoir péniblement arraché au ventre de sa mère. Il remplit l’espace de ses vagissements plaintifs, comme il est naturel à l’être qui a encore tant de maux à traverser. Pendant ce temps croissent heureusement les troupeaux de gros et petit bétail et les animaux sauvages, qui n’ont besoin ni du jeu de hochet ni d’entendre le doux et chuchotant babil d’une tendre nourrice ; il ne leur faut point de vêtements qui changent avec les saisons, point d’armes pour protéger leurs biens, points de hauts remparts, puisque à tous fournissent toutes choses abondamment la terre féconde et l’industrieuse nature.
Plutarque, Vie de Caton l'Ancien, XX, 4-8, texte établi et traduit par R. Flacelière et E. Chambry, CUF.
Après la naissance de son fils, aucune tâche urgente, sauf s’il s’agissait d’une affaire d’État, ne l’empêchait d’être auprès de sa femme, quand elle lavait ou emmaillotait le bébé. Elle le nourrissait elle-même de son lait. Souvent même elle donnait le sein aux petits enfants de ses esclaves, afin que cette nourriture commune leur inspirât de l’affection pour son fils. Dès que l’intelligence de l’enfant s’éveilla, Caton se chargea lui-même de lui apprendre à lire, bien qu’il eût un esclave, nommé Chilon, qui était un grammairien d’esprit très fin et qui avait beaucoup d’élèves. Il n’admettait pas, comme il le dit lui-même, qu’un esclave réprimandât son fils ou lui tirât les oreilles pour être trop lent à apprendre, ni que son fils fût redevable à un esclave d’un bienfait aussi précieux que l’éducation. Ce fut donc lui qui lui enseigna les lettres, qui lui apprit le droit et qui fut son maître de gymnastique. Il lui apprit non seulement à lancer le javelot, à combattre lourdement armé, à monter à cheval, mais encore à boxer, à endurer le chaud et le froid et à traverser à la nage le fleuve en forçant les passages difficiles et les tourbillons. Il dit aussi qu’il avait rédigé un livre d’histoire de sa propre main, en gros caractères, afin que son fils trouvât à la maison même le moyen de connaître les antiques traditions de son pays ; il ajoute qu’en présence de son fils, il se gardait de toute indécence de langage avec autant de soin que devant les vierges sacrées qu’on appelle Vestales, et qu’il ne se baigna jamais avec lui. Cela paraît avoir été une coutume générale chez les Romains. Les beaux-pères, en effet, évitaient de se baigner avec leurs gendres : ils eussent rougi de se déshabiller et de paraître nus devant eux. Par la suite cependant, quand ils eurent appris des Grecs à se montrer nus, à leur tour ils corrompirent les Grecs en leur donnant l’exemple de se baigner même avec des femmes.
Aristote, Politique, VII, 17, 4-6, texte établi et traduit par J. Aubonnet, CUF.
Jusqu’à ce qu’il ait cinq ans – période pendant laquelle il n’est pas encore bon de pousser l’enfant vers quelque étude que ce soit, ni à des tâches contraignantes, afin de ne pas gêner sa croissance –, on doit cependant maintenir assez de mouvement pour ne pas laisser le corps inactif ; et il faut y arriver grâce à diverses activités, et, en particulier, par le jeu. Mais les jeux eux-mêmes ne doivent être ni indignes d’hommes libres, ni fatigants, ni turbulents. Quant au genre d’histoires et légendes que les enfants de cet âge doivent entendre, que ce soit là le souci des magistrats appelés « inspecteurs de l’éducation ». Toutes ces activités doivent préparer la voie aux occupations futures ; c’est pourquoi les jeux doivent être, pour la plupart, des imitations des tâches sérieuses de l’avenir. Les grands cris des enfants et leurs pleurs bruyants, c’est à tort que les interdisent ceux qui les prohibent dans leurs lois, car ils sont utiles pour la croissance ; c’est, en quelque sorte, une gymnastique pour le corps : retenir son souffle donne de la force à qui fait des travaux pénibles, et c’est aussi le cas des petits enfants dans de telles tensions.
Plutarque, De l'amour de la progéniture, texte établi et traduit par J. Dumortier avec la collaboration de J. Defradas, CUF.
« De tout ce qui sur terre a souffle et mouvement, aucun être n’est plus misérable que l’homme. » Le poète ne ment pas, s’il parle ainsi du nouveau-né. Car rien n’est si imparfait, si indigent, si nu, si informe, si souillé que l’homme quand on le voit à sa naissance. Il est presque le seul à qui la nature a même refusé un accès immaculé à la lumière. Tout barbouillé de sang et plein de saleté, il fait plus penser à un assassinat qu’à une naissance, il n’est pas bon à toucher, ni à ramasser, ni à couvrir de baisers, ni à prendre dans les bras, sauf pour qui lui porte naturellement amour. Voilà pourquoi si les mamelles des autres animaux pendent sous le ventre, elles sont placées chez les femmes en haut, sur la poitrine, en un endroit qui permet de câliner, de donner des baisers et des caresses au tout petit, montrant que, en le mettant au monde et en le nourrissant, on n’a pas pour fin l’utilité mais l’affection.
[…]
[Aujourd’hui comme autrefois, les parents ont peu d’avantages à retirer de l’éducation de leurs enfants :] Les espérances sont incertaines et éloignées. On bine la vigne à l’équinoxe de printemps pour la vendanger à l’automne ; on sème le blé au coucher des Pléiades pour le moissonner à leur lever. Si les bœufs, les chevaux, les poules ont une fécondité toute prête à être utilisée, l’éducation de l’homme est pénible et sa croissance lente ; l’apparition de son mérite est tardive et la plupart des pères meurent avant. Néoclès ne vit point Thémistocle vainqueur à Salamine, ni Miltiade Cimon vainqueur sur l’Eurymédon, Xanthippe n’entendit pas Périclès professer la philosophie. Les pères d’Euripide et de Sophocle ne connurent point les victoires de leurs fils. Ils les entendirent balbutier et ânonner ; ils furent les spectateurs de leurs orgies, de leurs beuveries, de leurs amours, ces écarts de la jeunesse. Si bien que l’on peut rappeler avec éloge ce seul vers de l’œuvre d’Événos : « Un fils est toujours pour son père sujet de crainte et de chagrin ».
Néanmoins les parents ne laissent pas d’élever leurs enfants, surtout ceux qui en ont le moins besoin.
Sénèque, Des bienfaits, VI, 24, texte établi et traduit par François Préchac, CUF.
Ne vois-tu pas comme à l’âge tendre les enfants sont soumis de force par les parents à de salutaires épreuves ? Tandis qu’ils pleurent et se débattent, leurs corps sont méticuleusement tenus au chaud, et de peur que leurs membres, par l’effet d’une liberté prématurée, ne se déforment, on ménage la rectitude de leur développement en les tenant serrés, et puis les belles-lettres leur sont inculquées, au besoin par l’intimidation s’ils résistent ; finalement, l’entreprenante jeunesse est pliée à la frugalité, à la pudeur, à la moralité, en cas de docilité insuffisante par la force. Sont-ils des jeunes gens et déjà maîtres de leurs actes, même alors, s’ils repoussent les remèdes par crainte ou par indiscipline, on use avec eux de violence et de rigueur. Et voilà comment, entre tous les bienfaits de nos parents, les plus grands sont ceux que nous en reçûmes sans le savoir ou sans le vouloir.