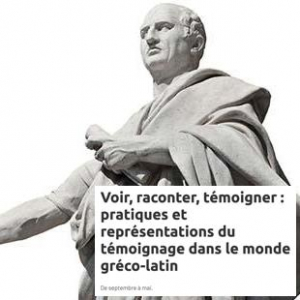
Dans un monde antique où la preuve matérielle n’occupe pas une place centrale, les témoins et leurs témoignages sont au fondement des pratiques de véridiction. Dès lors qu’il s’agit d’établir un fait, que ce soit au tribunal, dans l’espace politique, en histoire ou dans l’étude des phénomènes naturels, le premier recours possible est l’audition de ceux qui disent avoir vu.
La pratique testimoniale est très dépendante du contexte culturel dans lequel elle s’inscrit et se trouve régie par des règles et des attentes historiquement déterminées : pour comprendre le témoignage antique, il est bien sûr impossible de projeter nos usages et nos réflexes modernes. L’étude du témoignage ne peut donc se passer d’une « archéologie des savoirs ».
Or, s’il existe sur le sujet une littérature théorique importante, relevant effectivement de l’épistémologie (voir récemment Gelfert 2014, Shieber 2015, Reynolds 2017), il n’existe pas à ce jour d’histoire générale des usages et des représentations du témoin ou du témoignage dans l’antiquité, même si le témoignage judiciaire (Steck 2009, Guérin 2015, Siron 2020) et le témoignage scientifique (Lehoux 2012, König 2017) retiennent depuis quelques années l’attention des antiquisants.
Pour comprendre en quoi consiste l’acte testimonial dans l’antiquité, il est nécessaire d’aborder le phénomène sous trois angles complémentaires. L’un, proprement historique, doit porter sur les pratiques et les contextes dans leur dimension la plus concrète. Un deuxième angle est celui des représentations, et doit s’interroger sur les différents critères d’évaluation de la vérité et leur évolution. Enfin, un dernier angle proprement philologique s’impose, pour prendre en compte les distorsions et les silences que les textes dont nous disposons ont imposés aux pratiques antiques du témoignage.
L’Atelier rhétorique de Sorbonne Université se propose d’aborder ces réalités antiques et ces enjeux méthodologiques par une série de rencontres qui associeront hellénistes et latinistes sur un ensemble de cas concrets, et qui élargiront l’approche, à partir du fondement que représente l’histoire de la rhétorique et des institutions, à l’ensemble des contextes gréco-latins.
Les séances du séminaire se tiendront en hybride (salle D513 Maison de la recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente 75006 Paris) et par Zoom.
Romain Loriol (Lyon 3) : Le témoin face au divin
Sébastien Morlet (SU) : La preuve scripturaire comme témoignage dans les textes patristiques grecs (2e – 5e s.)
Louis Autin (SU) : Rumeurs et témoins chez les historiens latins (titre provisoire)
Pierre Pontier (SU) : Preuves, témoignages et causalité dans l’Histoire de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide