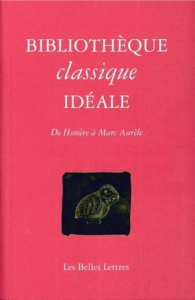
Jupiter et Junon se querellaient sur la question de savoir qui, de l’homme ou de la femme, éprouve le plus de plaisir. Ils décidèrent de s’en référer au devin Tirésias qui, né homme, était devenu femme pendant sept ans avant de retourner à son statut premier. Tirésias donna raison à Jupiter. Junon, mauvaise perdante, le rendit aveugle.
Jupiter lui accorda en échange la connaissance du futur. On vint désormais de loin pour consulter le devin Tirésias. Ainsi la Naïade Liriope, mère de Narcisse …
Je brûle d’amour pour moi-même.
J’allume la flamme que je porte dans
mon sein. Ce que je désire est en moi.
Tirésias, dans les villes de l’Aonie, où s’était répandue partout sa renommée, donnait ses réponses infaillibles au peuple qui venait le consulter. La première à tenter de lui faire confiance et à éprouver la véracité de ses dires fut Liriope aux cheveux d’azur ; jadis le Céphise l’enlaça dans son cours sinueux et, la tenant enfermée au milieu de ses ondes, il lui fit violence. Douée d’une rare beauté, elle conçut et mit au monde un enfant qui dès lors était digne d’être aimé des nymphes ; elle l’appela Narcisse. Elle vint demander s’il verrait sa vie se prolonger dans une vieillesse avancée ; le devin, interprète de la destinée, répondit : « S’il ne se connaît pas. » Longtemps ce mot de l’augure parut vain ; il fut justifié par l’événement, par la réalité, par le genre de mort de Narcisse et par son étrange délire. Déjà à ses quinze années le fils du Céphise en avait ajouté une ; il pouvait passer aussi bien pour un enfant et pour un jeune homme ; chez beaucoup de jeunes gens, chez beaucoup de jeunes filles il faisait naître le désir ; mais sa beauté encore tendre cachait un orgueil si dur que ni jeunes gens ni jeunes filles ne purent le toucher.
Un jour qu’il chassait vers ses filets des cerfs tremblants, il happa les regards de la nymphe à la voix sonore qui ne sait ni se taire quand on lui parle, ni parler la première, de la nymphe qui répète les sons, Écho. En ce temps là, Écho avait un corps ; ce n’était pas simplement une voix et pourtant sa bouche bavarde ne lui servait qu’à renvoyer, comme aujourd’hui, les derniers mots de tout ce qu’on lui disait. Ainsi l’avait voulu Junon ; quand la déesse pouvait surprendre les nymphes qui souvent, dans les montagnes, s’abandonnaient aux caresses de son Jupiter, Écho la retenait habilement par de longs entretiens, pour donner aux nymphes le temps de fuir. La fille de Saturne s’en aperçut : « Cette langue qui m’a trompée, dit-elle, ne te servira plus guère et tu ne feras plus de ta voix qu’un très bref usage. » L’effet confirme la menace ; Écho cependant peut encore répéter les derniers sons émis par la voix et rapporter les mots qu’elle a entendus.
Donc à peine a-t-elle vu Narcisse errant à travers les campagnes solitaires que, brûlée de désir, elle suit furtivement ses traces ; plus elle le suit, plus elle se rapproche du feu qui l’embrase ; le soufre vivace dont on enduit l’extrémité des torches ne s’allume pas plus rapidement au contact de la flamme. Oh ! que de fois elle voulut l’aborder avec des paroles caressantes et lui adresser de douces prières ! Sa nature s’y oppose et ne lui permet pas de commencer ; mais du moins puisqu’elle en a la permission, elle est prête à guetter des sons auxquels elle pourra répondre par des paroles.
Il advint que le jeune homme, séparé de la troupe de ses fidèles compagnons, cria : « Y a-t-il quelqu’un près de moi ? » « Moi » répondit Écho. Plein de stupeur, il promène de tous côtés ses regards. « Viens ! » crie-t-il à pleine voix ; à son appel elle répond par un appel. Il se retourne et, ne voyant venir personne : « Pourquoi, dit-il, me fuis-tu ? » Il recueille autant de paroles qu’il en a prononcé. Il insiste et, abusé par la voix qui semble alterner avec la sienne : « Ici ! reprend-il, réunissons-nous ! » Il n’y avait pas de mot auquel Écho pût répondre avec plus de plaisir : Unissons-nous ! » répète-t-elle et, appuyant en personne ce qu’elle a dit, elle sort de la forêt et veut jeter ses bras autour du cou tant espéré. Narcisse fuit et, tout en fuyant : « Retire ces mains qui m’enlacent, dit-il ; je mourrai avant que tu ne disposes de moi à ton gré ! » Elle ne répéta que ces paroles : « dispose de moi à ton gré ! » Méprisée, elle se cache dans les forêts ; elle abrite sous la feuillée son visage accablé de honte et depuis lors elle vit dans des antres solitaires ; mais son amour est resté gravé dans son coeur et le chagrin d’avoir été repoussée ne fait que l’accroître. Les soucis qui la tiennent éveillée épuisent son corps misérable, la maigreur dessèche sa peau, toute la sève de ses membres s’évapore. Il ne lui reste que la voix et les os ; sa voix est intacte, ses os ont pris, dit-on, la forme d’un rocher. Depuis, cachée dans les forêts, elle ne se montre plus sur les montagnes ; mais tout le monde l’entend ; un son, voilà tout ce qui survit en elle.
Comme cette nymphe, d’autres, nées dans les eaux ou sur les montagnes, et auparavant une foule de jeunes hommes s’étaient vus dédaignés par Narcisse. Aussi une victime de ses mépris, levant les mains vers le ciel, s’écria : « Puisset-il aimer, lui aussi, et ne jamais posséder l’objet de son amour ! » La déesse de Rhamnonte exauça cette juste prière. Il y avait une source limpide dont les eaux brillaient comme de l’argent ; jamais les pâtres ni les chèvres qu’ils faisaient paître sur la montagne, ni aucun autre bétail ne l’avaient effleurée, jamais un oiseau, une bête sauvage ou un rameau tombé d’un arbre n’en avait troublé la pureté. Tout alentour s’étendait un gazon dont ses eaux entretenaient la vie par leur voisinage, et une forêt qui empêchait le soleil d’attiédir l’atmosphère du lieu. Là le jeune homme, qu’une chasse ardente et la chaleur du jour avaient fatigué, vint se coucher sur la terre, séduit par la beauté du site et par la fraîcheur de la source. Il veut puiser sa soif ; mais il sent naître en lui une soif nouvelle ; tandis qu’il boit, séduit par l’image de sa beauté qu’il aperçoit, il se passionne pour une illusion sans corps ; il prend pour un corps ce qui n’est que de l’eau ; il s’extasie devant lui-même ; il demeure immobile, le visage impassible, semblable à une statue taillée dans le marbre de Paros. Étendu sur le sol, il contemple ses yeux, deux astres, sa chevelure digne de Bacchus et non moins digne d’Apollon, ses joues lisses, son cou d’ivoire, sa bouche gracieuse, son teint qui à un éclat vermeil unit une blancheur de neige ; enfin il admire tout ce qui le rend admirable. Sans s’en douter, il se désire lui-même ; il est l’amant et l’objet aimé, le but auquel s’adressent ses voeux ; les feux qu’il cherche à allumer sont en même temps ceux qui le brûlent. Que de fois il donne de vains baisers à cette source fallacieuse ! Que de fois, pour saisir son cou, qu’il voyait au milieu des eaux, il y plongea ses bras, sans pouvoir s’atteindre ! Que voit-il ? Il l’ignore ; mais ce qu’il voit le consume ; la même erreur qui trompe ses yeux les excite. Crédule enfant, pourquoi t’obstines-tu vainement à saisir une image fugitive ? Ce que tu recherches n’existe pas ; l’objet que tu aimes, tourne-toi et il s’évanouira. Le fantôme que tu aperçois n’est que le reflet de ton image ; sans consistance par soi-même, il est venu et demeure avec toi ; avec toi il va s’éloigner, si tu peux t’éloigner.
Ni le souci de Cérès, ni le besoin de sommeil ne peuvent l’arracher de ce lieu ; couché sur l’herbe épaisse, il contemple d’un regard insatiable l’image mensongère ; il meurt, victime de ses propres yeux ; légèrement soulevé et tendant ses bras vers les arbres qui l’entourent : « Jamais amant, dit-il, ô forêts, a-t-il subi un sort plus cruel ? Vous le savez ; car vous avez souvent offert à l’amour un refuge opportun. Vous, dont la vie compte tant de siècles, vous souvient-il d’avoir jamais vu dans cette longue suite de temps un amant dépérir comme moi ? Un être me charme et je le vois ; mais cet être que je vois et qui me charme, je ne puis l’atteindre ; si grande est l’erreur qui contrarie mon amour. Pour comble de douleur, il n’y a entre nous ni vaste mer, ni longues routes, ni montagnes, ni remparts aux portes closes ; c’est un peu d’eau qui nous sépare. Lui aussi, il désire mon étreinte, car chaque fois que je tends mes lèvres vers ces eaux limpides pour un baiser, chaque fois il s’efforce de lever vers moi sa bouche. Il semble que je puis le toucher ; un très faible obstacle s’oppose seul à notre amour. Qui que tu sois, viens ici ; pourquoi, enfant sans égal, te jouer ainsi de moi ? Où fuis-tu, quand je te cherche ? Ce ne sont du moins ni ma figure, ni mon âge qui peuvent te faire fuir ; des nymphes même m’ont aimé. Ton visage amical me promet je ne sais quel espoir ; quand je te tends les bras, tu me tends les tiens de toi-même ; quand je te souris, tu me souris.
Souvent même j’ai vu couler tes pleurs, quand je pleurais ; tu réponds à mes signes en inclinant la tête et, autant que j’en puis juger par le mouvement de ta jolie bouche, tu me renvoies des paroles qui n’arrivent pas jusqu’à mes oreilles. Mais cet enfant, c’est moi ; je l’ai compris et mon image ne me trompe plus ; je brûle d’amour pour moi-même. J’allume la flamme que je porte dans mon sein. Que faire ? Attendre d’être imploré ou implorer moi-même ? Et puis, quelle faveur implorer maintenant ? Ce que je désire est en moi ; ma richesse a causé mes privations. Oh ! que ne puis-je me séparer de mon corps ! Voeu singulier chez un amant, je voudrais que ce que j’aime fût loin de moi. Déjà la douleur épuise mes forces ; il ne me reste plus longtemps à vivre, je m’éteins à la fleur de mon âge. La mort ne m’est point cruelle, car elle me délivrera de mes douleurs ; je voudrais que cet objet de ma tendresse eût une plus longue existence ; mais, unis par le coeur, nous mourrons en exhalant le même soupir. »
À ces mots, il revint, dans son délire, contempler son image ; ses larmes troublèrent les eaux et l’agitation du bassin obscurcit l’apparition. Quand il la vit s’effacer : « Où fuis-tu, cria-t-il ? Demeure ; n’abandonne pas, cruel, celui qui t’adore. Ce que je ne puis toucher, laisse-moi au moins le contempler ! Laisse-moi fournir un aliment à ma triste folie ! » Au milieu de ces plaintes, il arracha son vêtement depuis le haut et, de ses mains blanches comme le marbre, il frappa sa poitrine nue, qui, sous les coups, se colora d’une teinte de rose ; ainsi des fruits, blancs d’un côté, sont, de l’autre, nuancés de rouge ; ainsi la grappe de raisin aux tons changeants se tache de pourpre, quand elle n’est pas encore mûre. À peine eut-il vu ces meurtrissures dans l’onde redevenue limpide qu’il n’en put supporter davantage ; comme la cire dorée fond devant une flamme légère ou le givre du matin sous un tiède rayon de soleil, ainsi il dépérit, consumé par l’amour, et il succombe au feu secret qui le dévore lentement. Il a perdu ce teint dont la blancheur se colorait d’un éclat vermeil ; il a perdu son air de santé, ses forces et tous les charmes qu’il admirait naguère ; dans son corps il ne reste plus rien de la beauté que jadis Écho avait aimée. Quand elle le revit, bien qu’animée contre lui de colère et de ressentiment, elle le prit en pitié ; chaque fois que le malheureux jeune homme s’était écrié : « Hélas ! » la voix de la nymphe lui répondait en répétant : « Hélas ! » Quand de ses mains il s’était frappé les bras, elle lui renvoyait le son de ses coups. Les dernières paroles qu’il prononça en jetant, selon sa coutume, un regard dans l’onde, furent : « Hélas ! enfant que j’ai vainement chéri ! » Les lieux d’alentour retentirent des mêmes mots en nombre égal ; il avait dit : « Adieu ! » – « Adieu ! » répliqua Écho. Il laissa tomber sa tête lasse sur le vert gazon ; la mort ferma ses yeux qui admiraient toujours la beauté de leur maître. Même après qu’il fut entré au séjour infernal, il se regardait encore dans l’eau du Styx. Ses soeurs, les Naïades1, le pleurèrent et, ayant coupé leurs cheveux, les consacrèrent à leur frère ; les Dryades le pleurèrent aussi ; Écho répéta leurs gémissements. Déjà on préparait le bûcher, les torches qu’on secoue dans les airs et la civière funèbre ; le corps avait disparu ; à la place du corps, on trouve une fleur couleur de safran, dont le centre est entouré de blancs pétales.
Les Métamorphoses, III, 340-511