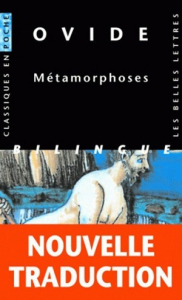
Ovide – Les Métamorphoses, I, 568-761
Le Tempé, val boisé ceint d’abruptes forêts,
Abrite en Thessalie la source où le Pénée
Jaillit du pied du Pinde en puissante cascade,
Roule ses eaux, écume, en vapeur s’ennuage,
Monte, retombe en pluie sur la cime des arbres,
Et fatigue l’écho du fracas de sa chute.
C’est l’antre, le séjour, la retraite sacrée
Du grand fleuve. Assis là dans un rocher creusé,
Il dit leurs lois aux eaux et aux nymphes des eaux.
Les fleuves y confluent, d’abord les plus voisins,
Doutant s’il leur faut rire ou pleurer avec lui.
Sperchios-aux-peupliers, Enipée jamais quiet,
Le vieillard Éridan, Éas, le doux Amphryse,
Bien d’autres de partout, dont le cours impétueux
Mène à la mer l’onde lassée de longs détours.
Seul absent, Inachus, tapi dans sa caverne,
De longs sanglots se gonfle, et, père infortuné,
Pleure Io disparue. Vit-elle ? Est-elle morte ?
Il l’ignore et la cherche, et ne la trouvant pas
Il croit qu’elle n’est plus, ou craint bien pire encor.
Jupiter l’a croisée s’en revenant du fleuve.
Vierge, lui dit le dieu, digne de Jupiter,
Dont le lit comblera quelque amant, viens sous l’ombre
De ces hautes futaies (il montrait un bois sombre).
Le soleil darde à plein. Il fait chaud. Si tu crains
De t’aventurer seule aux repaires des bêtes,
Un dieu t’escortera jusqu’au fond des forêts,
Non pas dieu plébéien, mais moi, maître des cieux,
Qui tiens en main le sceptre et fais jaillir la foudre !
Ne fuis pas ! Elle fuit, passe les prés de Lerne
Et les champs du Lyrcée d’arbres ensemencés,
Quand lui, d’un noir nuage enténébrant la terre,
L’arrête dans sa fuite et lui ravit l’honneur.
À cet instant, Junon, jetant l’œil vers les champs,
S’étonna qu’un brouillard y eût si brusquement
Fait la nuit en plein jour alors que ni des fleuves
Ni de la terre humide il ne semblait monter.
Elle inspecte alentour si son mari est là,
(Trop de flagrants délits l’avaient trop édifiée),
Ne le voit pas au ciel, se dit : Ou je me trompe,
Ou il me trompe, lui, dévale des éthers,
Met pied à terre, et donne au brouillard son congé.
Mais lui, qui prévoit tout, avait changé Io
En génisse au pelage éclatant de blancheur.
Même telle, elle est belle. Admirant malgré elle
Ses formes, Junon feint l’ignorance et s’enquiert
D’où elle vient ? De quel troupeau ? Quel éleveur ?
Pour couper court Jupiter ment et lui raconte
Qu’elle est née de la terre. Offre-la moi, dit-elle.
Que faire ? Il est cruel de livrer sa maîtresse,
Suspect de refuser. Dis non, plaide l’amour,
Oui, rougit le remords. L’amour l’eût emporté
Si refuser à une épouse une génisse
N’eût pu faire douter qu’elle fût vraie génisse.
Pas vraiment rassurée par le cadeau, Junon,
De peur que Jupiter lui vole sa rivale,
Lui donna pour gardien Argus, fils d’Arestor.
Argus avait la tête entourée de cent yeux.
Deux des cent yeux dormaient toujours, jamais les mêmes,
Les autres, éveillés, restaient en surveillance.
Où qu’Argus se portât ils regardaient vers elle.
Même tourné de dos il épiait la génisse.
Le jour il la met paître, au coucher du soleil
Il la parque, entravée d’un indigne licou.
Nourrie de feuilles d’arbre et d’herbages amers,
Elle dort sur le sol et souvent sans litière
Et n’a pour s’abreuver que de fangeux cours d’eau.
Voulant tendre ses bras pour supplier Argus,
Elle n’a pas de bras pour les tendre à Argus,
Voulant se plaindre, arrive à mugir seulement.
Ce bruit la terrifie et sa voix l’épouvante.
Elle va vers la rive où elle aimait jouer,
Et, découvrant dans l’eau de l’Inachus son mufle
Cornu, s’effraie, recule, et se fuit elle-même.
Les naïades ses sœurs et l’Inachus son père,
Ignorent qui elle est. Mais elle, elle les suit,
S’offre à l’admiration et se laisse toucher.
Le vieillard Inachus cueille et lui tend des herbes.
Elle, léchant ses mains et embrassant ses paumes,
Ne peut tenir ses pleurs, faute de mots pour dire
Son nom et son malheur et crier au secours.
Du pied dans la poussière elle trace les phrases
Narrant l’affreux secret de sa métamorphose.
Malheur sur moi ! crie Inachus, pendu aux cornes
Et au cou gémissant de la blanche génisse.
Malheur, deux fois malheur ! Est-ce bien toi, ma fille,
Que j’ai cherchée partout ? Ah ! Mon deuil était moindre
De ne pas te trouver ! Je parle, tu te tais,
Privée de mots, n’ayant pour répondre à ma voix
Que ces profonds soupirs et ces mugissements !
Pour ta noce apprêtant, naïf, flambeaux et couche,
J’avais l’espoir d’un gendre et d’un petit-enfant :
Le troupeau fournira le mâle avec le veau !
Même la mort ne peut mettre un terme à mes peines,
Sa porte m’est fermée, hélas, être dieu nuit,
Et mon deuil doit durer toute une éternité !
Tandis qu’il geint, Argus constellé d’yeux le pousse,
Saisit sa fille, et la conduit paître à l’écart,
Puis se poste alentour au sommet d’un haut mont
D’où il surveille, assis, toutes les directions.
Mais pour le roi d’En-Haut c’est trop navrer d’épreuves
La Phoronide. Il mande au fils qu’une Pléiade
Lumineuse eut de lui de mettre à mort Argus.
Chaussant ses ailes, vite, en main son caducée
Qui répand le sommeil, et coiffant son pétase,
Du séjour paternel Hermès descend sur terre.
Là, ôtant son chapeau, déposant ses deux ailes,
Gardant le caducée qui lui sert de bâton,
Comme un berger, il mène à travers champs des chèvres
Venues du ciel, fabrique un chalumeau, et joue.
Ravi par son talent et sa musique neuve,
Argus lui dit : Passant, viens t’asseoir près de moi
Sur ce roc. Nulle part il n’est d’herbe plus grasse
Aux troupeaux, ni d’ombrage aux pâtres plus propice.
Le petit-fils d’Atlas prend place, en longs récits
Retient le jour qui fuit, et des roseaux liés
Le chant s’essaie à endormir les yeux d’Argus.
Mais le monstre combat les douceurs du sommeil,
Et si bon nombre d’yeux sont déjà assoupis
D’autres veillent encor. Enfin de la syrinx,
récente invention, il veut savoir l’histoire.
Aux monts glacés de l’Arcadie, entame Hermès,
Illustre à Nonacris chez les Hamadryades
Fut Syrinx la naïade, ainsi nommée des nymphes.
Elle avait bien souvent échappé aux satyres
Et aux dieux harceleurs des futaies et des champs.
Ses goûts, sa chasteté la vouaient à servir
La déesse ortygienne. Haut ceinturée comme elle,
Si son arc n’eût été de corne en place d’or,
On l’eût crue la vraie Diane et fille de Latone.
D’ailleurs on s’y trompait. Pan, que le pin couronne,
La voyant qui venait du mont Lycée, lui tint
Ce discours : – Il restait à dire le discours,
La fuite à travers champs de la nymphe insensible
Jusqu’aux paisibles eaux du Ladon sablonneux
Où, sa course arrêtée par l’obstacle de l’onde,
De ses liquides sœurs elle implore un miracle,
À dire comme Pan, croyant saisir Syrinx,
Serre un roseau palustre au lieu d’un corps de nymphe,
Comme encor d’un soupir il insuffle au calame
Un son suave et léger, semblable à une plainte,
S’écrie, charmé de cet art neuf et mélodieux :
Qu’à tout jamais ainsi nous devisions ensemble !
Puis à la cire assemble d’inégaux tuyaux
Et donne à l’instrument le nom de la naïade –
Mais prêt à tout narrer, Hermès vit que d’Argus
Tous les yeux s’étaient clos accablés de sommeil.
Aussitôt il se tait, passe son caducée,
Pour l’endormir plus fort, sur ses lourdes paupières,
Puis sur son cou penché assène un coup de serpe
À la nuque et la fait rouler, ensanglantée,
Dans le ravin, éclaboussant son flanc abrupt.
Tu gis, Argus, les feux de tes regards s’éteignent,
Et une même nuit envahit tes cent yeux.
Junon, les recueillant, brillants comme des gemmes,
En constella la queue de l’oiseau qu’elle aimait,
Puis, flambant de colère et sans désemparer,
Met sous les yeux et fiche au cœur de sa rivale
L’effroyable Erinys, aiguillon de folie
Qui l’envoie terrifiée fuir à travers le monde.
Tu fus le terme, ô Nil, de ses tourments sans borne.
Sitôt qu’elle toucha à la rive du fleuve,
À genoux, col ployé vers l’arrière, élevant
Son chef, faute de mains, vers la voûte étoilée,
Elle gémit et pleure et mugit, lamentable,
Comme pour appeler Jupiter au secours.
Et lui, passant ses bras au cou de son épouse,
Supplie qu’elle gracie enfin la condamnée :
Ne crains plus rien, dit-il, jamais plus celle-là,
Le Styx m’en soit témoin, ne te fera souffrir !
La déesse apaisée, Io reprend sa forme
D’hier, ses poils s’enfuient, s’évanouissent ses cornes,
L’orbite de ses yeux se rétrécit, son mufle
Mincit, il lui revient des bras et des épaules,
Et pour chaque sabot tombé cinq ongles poussent.
Seul son blanc éclatant la fait génisse encor.
Deux pieds lui suffisant, la nymphe se redresse,
Et, sans trop se hâter de crainte de mugir,
S’essaie timidement à rapprendre à parler.
Déesse illustre enfin, l’Égypte la vénère
En maint temple voisin de celui d’épaphus,
Fils qu’elle eut, y croit-on, du très-haut Jupiter.
Par l’âge et l’assurance il égalait Phæton,
Né du Soleil. Un jour qu’en sa vaine gloriole
Celui-ci refusait de lui céder le pas,
Révolté, il lui dit : Fou qui crois trop ta mère,
Et te gonfles d’orgueil d’un père imaginaire !
Phæton rougit. La honte étouffa sa colère.
À Clymène sa mère il rapporta l’insulte.
Le plus dur, lui dit-il, est que moi, libre et fier,
Me sois tu sous l’outrage et sous la double honte
D’avoir pu le subir, sans pouvoir y répondre.
Mais toi, s’il est bien vrai que je suis né d’un dieu,
Ô mère, assure-m’en et la preuve et le gage !