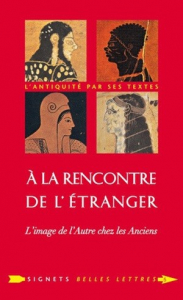
Voici l'entretien liminaire du Signet A la rencontre de l'étranger avec Pascal Charvet, Inspecteur général de lettres.
LAURE DE CHANTAL ET GÉRARD SALAMON: La première question que nous voudrions vous poser est celle, sans doute, que vont se poser la plupart des lecteurs en abordant cet ouvrage: quelle peut-être sur un sujet comme l’image de l’étranger, l’actualité de textes écrits par des auteurs issus d’un monde à la fois très proche et très éloigné du nôtre?
PASCAL CHARVET: Comme vous le soulignez, l’altérité radicale du monde de l’Antiquité par rapport au nôtre ne doit jamais être négligée, mais nous avons besoin de nous confronter à cette altérité et d’opérer ce détour par l’Antiquité pour interpréter et réinscrire ses valeurs dans le temps présent. L’Antiquité est en effet tout autant une construction constante, intellectuelle et sensible, qu’une réalité historique. Étudier la vision, historiquement datée, que les Grecs et les Romains avaient de l’étranger, c’est étudier ce qu’étaient leur propre grécité, leur propre romanité, confrontées au problème de l’autre. La question de l’altérité est toujours d’actualité, même si elle ne se pose pas nécessairement dans les mêmes termes aujourd’hui: mais c’est précisément cet écart qui nous permet de tirer un enseignement des textes anciens, de faire d’eux « un réservoir du nouveau ». De façon plus générale, c’est là, à mon avis, tout l’intérêt de la lecture des auteurs grecs et romains: il ne s’agit pas de réapprendre des savoirs dits « éternels » mais d’acquérir une culture dynamique qui permette de s’orienter dans l’opacité des systèmes et des signes d’aujourd’hui à la lumière de ce que les Anciens peuvent nous apprendre par les valeurs qui étaient les leurs – celles qui subsistent comme celles qui ont disparu – mais aussi par leur manière particulière d’aborder les questions elles-mêmes. C’est ainsi que l’on rend intelligible le regard que nous portons sur notre propre histoire – celle, aussi de notre langue et de notre littérature –, à l’intérieur du monde contemporain.
En ce qui concerne l’étranger, il apparaît comme évident, à la lecture des textes, que la situation n’est pas exactement la même en Grèce et à Rome.
Oui. Même si les contacts entre les Grecs et les Romains sont très anciens – ils sont bien antérieurs à la conquête par Rome du monde méditerranéen –, il y a entre les deux peuples une différence fondamentale. Les Grecs conçoivent le monde comme partagé en deux et y opèrent une sorte de catégorisation binaire qui les oppose aux autres, globalement désignés sous le nom de Barbares. Mais il faut prendre garde aux erreurs de perspective: dans la pratique, l’opposition entre Grecs et Barbares, que certains se sont plu à souligner, n’est pas du tout aussi rigide qu’on pourrait le penser. Platon lui-même critique ceux qui opèrent cette partition en ignorant l’infinie diversité de ceux qui ne parlent pas la même langue que les Grecs. Les cités grecques ont eu de nombreux contacts, par la guerre ou le commerce, avec les « Barbares » (jusqu’en Inde) et l’on connaît les liens qu’ils ont noués avec les Égyptiens: dès au moins le VIIe siècle avant J.-C., il y eut un comptoir grec à Naucratis en Égypte. On ne peut donc ramener l’attitude des Grecs vis-à-vis des étrangers à de la xénophobie au sens étroit du terme, même si la xénophobie a bel et bien existé en Grèce: il s’agit d’une représentation du monde dans laquelle se trouvent, d’un côté, ceux qui partagent un ensemble de valeurs bien précises, et surtout politiques, les citoyens, et, de l’autre, ceux qui ne les partagent pas et qui sont de ce fait étrangers, des non-citoyens, ce qui n’interdit cependant pas d’avoir avec eux des relations d’hospitalité parfois très étroites. La division bipartite du monde qui existe chez les Grecs est donc plus intellectuelle que concrète: mais elle les a conduits à avoir une politique d’intégration beaucoup plus restrictive que celle qui a été pratiquée par les Romains.
Qu’en est-il exactement à Rome?
Ce qui est en effet fascinant chez les Romains, et qui a fait leur grande force, c’est leur capacité à assimiler sans cesse les étrangers (de la même manière qu’ils intégraient dans leur panthéon les dieux de tous les peuples), au point qu’on pouvait accuser le peuple romain – ainsi dans le discours de Mithridate – d’être un ramassis d’immigrants (colluuies conuenarum). Cependant ne faisons pas non plus de Rome un modèle idéal de civilisation: les Romains avaient eux aussi développé toute une série de stéréotypes à l’égard de certains peuples et manifestaient souvent de la méfiance envers les étrangers, à commencer par les Grecs ou les Égyptiens. Mais il n’y a pas à Rome de préjugé fondamental à l’encontre de l’étranger parce que l’étranger est quelqu’un qui est appelé, ou peut être appelé, à devenir romain, à condition bien entendu qu’il ait montré qu’il accepte d’adhérer aux valeurs de la cité. Il s’agit d’une attitude constante. On peut certes avoir le sentiment que cela change au IIIe siècle après J.-C., lorsque se concrétise la menace barbare sur l’Empire et que le concept de « Barbare », qui ne s’est jamais vraiment ancré à Rome, va être utilisé pour désigner ceux dont nous évoquons nous-mêmes encore aujourd’hui (avec souvent des connotations péjoratives bien plus véhémentes) les « invasions barbares ». Mais même alors, il s’est agi moins de racisme à proprement parler que d’une manière de ressouder les Romains, de reformer l’union sacrée contre l’envahisseur. La différence entre la Grèce et Rome est donc bien réelle; mais on pourrait dire également que l’hellénisme, fort de sa vocation universelle, a contribué à mettre en place un système dans lequel l’autre, s’il n’est pas concrètement assimilé, est malgré tout appelé à devenir le même.
À ce propos, on peut noter que chez Hérodote le terme de « Barbares » ne s’applique pas à certains peuples, comme les Égyptiens. Par ailleurs, ce terme n’a pas le même sens en Grèce et à Rome. Pourriez-vous dire quelques mots de l’origine et de l’évolution de ce mot?
Le terme a été forgé par Homère pour nommer les combattants non grecs de la Guerre de Troie. Homère crée l’adjectif « barbarophone », désignant ceux qui parlent par onomatopées (bar, bar, bar…) et dont le langage n’est pas compréhensible. Mais le mot n’a pas de connotation raciste: les barbares sont avant tout des hommes extérieurs à la communauté culturelle et linguistique des Grecs. Les Romains n’accepteront pas vraiment ce concept, car ils sont eux-mêmes, dans cette définition grecque, inclus dans la catégorie des « Barbares », et Plaute ne manquera pas de les désigner ainsi. D’où peut-être, pour une part, la réticence chez les Romains à adopter un principe de catégorisation du type Romains/non-Romains.
Un autre terme est souvent galvaudé: c’est celui de métèque. Qui désigne-t-il exactement dans une cité grecque?
Le mot « métèque » désigne ceux que nous appellerions des « étrangers résidents » et, si ce sont parfois des Barbares, ce sont surtout des Grecs originaires d’autres cités que celle dans laquelle ils vivent. Dans celle-ci, ils constituent une catégorie à part : ils ne disposent pas des droits des citoyens, mais ils sont soumis aux impôts et à l’obligation militaire. Les naturalisations étant rares, les métèques sont amenés le plus souvent à rester des étrangers, même s’ils sont installés depuis longtemps, parfois plus d’une génération, dans leur cité d’accueil.
La situation est très différente à Rome où le peregrinus, l’étranger installé dans la cité, peut assez facilement devenir citoyen romain.
Oui. À Rome, l’étranger peut demander à devenir citoyen, à condition bien entendu qu’il renonce à sa précédente nationalité car la binationalité est impossible pour un citoyen romain; mais il a en quelque sorte le choix. D’après les Romains eux-mêmes, c’est ce qui explique le développement de leur ville dont la population s’accroissait sans cesse. Et c’est sans doute en partie vrai: on sait que les cités grecques, qui intégraient difficilement les étrangers, ont connu de graves problèmes au fur et à mesure que leur corps civique diminuait en nombre.
Ne peut-on pas dire cependant que les Romains ont été en quelque sorte contraints d’adopter une politique d’intégration des étrangers? Les Grecs sont un peuple, les Romains sont les habitants d’une cité: s’ils ont été amenés assez vite, par la force des choses, à dissocier la résidence dans la cité et la citoyenneté, n’est-ce pas simplement parce que Rome ne pouvait pas se développer uniquement avec ses propres forces?
Certes, on peut envisager les choses de cette façon-là et cela me paraît tout à fait fondé. Cependant, il me semble que derrière ce qu’on a appelé le « génie romain », c’est-à-dire cette capacité qu’avait la cité à étendre sa domination, il y a quand même l’aptitude des Romains à comprendre l’autre et à prendre chez lui ce qui pouvait servir au développement et à la puissance de leur ville. Il y a bien entendu des résistances aux apports étrangers, dont on craint qu’ils n’affectent les valeurs ancestrales, mais Rome, pour moi, se définit aussi par cette incroyable plasticité, cette aptitude toute particulière à intégrer ce qui vient d’ailleurs.
De façon plus générale, ne pourrait-on pas dire que le monde antique est, aussi loin que l’on puisse remonter, un monde mêlé?
À la lecture des textes, on a l’impression d’un univers en perpétuel changement: des peuples y changent de résidence et s’installent dans de nouveaux pays, que ce soit pacifiquement ou par la conquête. Le monde antique est assurément un monde mêlé et mobile, dans lequel les divers peuples sont constamment en contact et se sont largement métissés. Ce sont quelques historiens, surtout au XIXe siècle, qui ont faussé la réalité en voulant imposer la vision d’un monde grec – pour le monde romain cela était quasiment impossible – pur de toute influence étrangère. Mais en réalité, plus les recherches – et en particulier les recherches archéologiques – progressent, plus on prend conscience de l’ancienneté de ce métissage ; on ne peut évidemment pas parler d’une race grecque ni d’une race romaine : ce serait la pire des âneries, exactement comme si l’on tenait ce discours à propos de la France d’aujourd’hui.
Ne peut-on pas attribuer également à ce mélange, comme un certain nombre de textes anciens nous engagent explicitement à le faire, le développement économique du monde méditerranéen?
L’arrivée des Grecs, des Carthaginois ou des Romains dans une région donnée contribue, en effet, à l’enrichir et pas seulement par les échanges commerciaux qu’elle génère. Les colonies grecques, en particulier, constituent des modèles pour les populations locales et leur création fait évoluer l’organisation sociale des peuples avec lesquels elles sont en contact. Plus tard, lorsque le monde est dominé par Rome, il y règne une certaine sécurité – même s’il y aurait beaucoup à dire sur la fameuse pax Romana – et les communications y sont faciles grâce aux routes que les Romains y ont tracées. Ces routes avaient évidemment pour but premier de faciliter les déplacements des armées – les Romains n’agissaient pas par philanthropie – mais elles avaient pour conséquence de faciliter les échanges qui existaient antérieurement et de contribuer au développement du pays et à l’enrichissement général.
Cet enrichissement n’est-il pas également culturel? On sait que les jeunes Romains de la bonne société allaient, à l’époque classique, passer un certain temps à l’étranger, même s’il s’agissait d’un étranger proche puisqu’ils allaient en Grèce.
Vous avez raison d’insister là-dessus, et le parallèle est évidemment tentant avec ce que nous essayons aujourd’hui de développer dans nos universités. Le voyage des jeunes Romains en Grèce apparaît de fait comme un rituel d’initiation qui précède l’entrée effective dans la cité. Mais de façon plus générale, il est intéressant de constater que l’on voyage beaucoup dans l’Antiquité et pour toutes sortes de raisons, pas seulement commerciales, même si la possibilité de voyager différait selon les classes sociales. Malgré les difficultés et les dangers des voyages qui se faisaient essentiellement par voie maritime – les naufrages étaient fréquents et l’on pouvait toujours croiser des pirates – l’étranger exerce assez souvent un véritable attrait au point que l’on peut même parler sans anachronisme de tourisme. En travaillant avec Jean Yoyotte sur Le Voyage en Égypte de Strabon, j’avais été frappé par le nombre important des graffiti, parfois très émouvants, laissés par des touristes romains et grecs sur les murs ou les colonnes des temples égyptiens. On croise des étrangers chez soi, mais évidemment c’est autre chose que d’aller sur place; et lorsque l’on est dans un pays étranger ou dans une cité qui n’est pas la sienne, on tient à en découvrir les curiosités.
Pourtant l’ostracisme, ou pire, l’exil définitif étaient considérés comme de véritables châtiments.
C’est juste. On peut même dire que l’exil était considéré comme une peine pire que la mort elle-même puisqu’un exil volontaire permettait d’échapper à la peine capitale. Mais le châtiment ne réside pas dans l’obligation qui est faite à un individu de vivre à l’étranger, il est dans son exclusion de la cité. Or, pour un Grec comme pour un Romain, c’est l’appartenance à la cité qui prime sur tout le reste, c’est elle qui lui donne son identité. Et c’est le fait que cette valeur soit essentielle qui donne à la cité, en Grèce et à Rome, sa force, y compris au combat, comme l’a fortement souligné Aristote. Il faut bien comprendre que l’attachement à la cité n’est pas d’abord dirigé contre l’autre, il est avant tout une manière de se définir comme appartenant à une collectivité dont on accepte les valeurs. Le lien à la cité, que l’on a tendance aujourd’hui à minorer, est donc vital pour les Grecs et les Romains, en ce qu’il donne à l’individu son identité. De ce point de vue, le détour par les textes anciens, dont je parlais au début de cet entretien est, me semble-t-il, particulièrement instructif. Il permet de prendre conscience de ce que la culture antique peut apporter à la formation d’un homme d’aujourd’hui: les textes anciens placent le lecteur en face de la question fondamentale de l’altérité, qui est d’abord celle des Grecs et des Romains eux-mêmes, et lui donnent les moyens de comprendre, sans bien entendu rabattre les catégories d’hier sur celles d’aujourd’hui, ce qu’est la relation à l’autre. Mieux: à un moment où il y a, par peur de la mondialisation, un repli frileux des individus sur leur identité, sur leur communauté, apprendre à forger son identité profonde à travers l’altérité – ici celle des Grecs et des Romains – me paraît essentiel. Pierre Grimal disait que « la liberté véritable ne commence que si l’esprit est transporté dans un univers mentalement et spirituellement différent ». C’est, en effet, à partir d’une culture vivante qui connaît ses origines que l’on peut comprendre les valeurs des autres peuples et neutraliser, pour une part, le pouvoir qui fut si souvent mortifère des frontières, en sachant se placer aussi de l’autre côté.