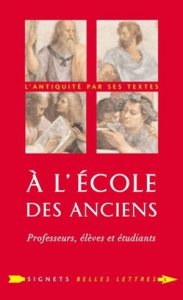
Palladas
Description crue des difficultés que les maîtres éprouvaient à se faire payer.
PETITS GAINS LABORIEUX
Ici enseignent tous ceux qui excitent les courroux de Sarapis, ceux qui commencent par la « pernicieuse colère ». Ici la nourrice, chaque mois, apporte le salaire à contrecœur, ayant dans la feuille d’un livre enveloppé cette misère. Ainsi que de l’encens, elle pose près de la chaire, comme sur une tombe, le petit papier, qu’elle jette négligemment. Sur cette pauvre somme elle se dérobe un salaire, elle substitue du cuivre à l’argent, elle mêle du plomb, et elle reçoit le présent habituel. Et si quelque élève doit, pour l’année écoulée, une pièce d’or, le onzième mois, avant de l’apporter, il change de maître, montrant ainsi son ingratitude et dépouillant le premier grammairien, qu’il prive du salaire de toute une année.
Anthologie grecque, IX, 174
Juvénal
Dans une satire consacrée à l’inégalité des conditions à Rome et à la dégradation du niveau de vie des intellectuels, Juvénal attire l’attention sur le cas du professeur d’enseignement secondaire, le « grammairien ». Il y a tout lieu de le plaindre, si l’on considère les exigences exorbitantes des parents (qui demandent un savoir sans faille dans tous les domaines, de l’adresse, de l’autorité), les conditions de travail déprimantes (cours très tôt le matin, lourds effectifs d’enfants turbulents) et le salaire dérisoire (en un an, juste autant qu’un cocher victorieux au cirque).
UN SALAIRE, MAIS À QUEL PRIX !
Qui verse dans la poche de Celadus et du docte Palaemon autant que le mérite leur labeur de grammairiens ? Et cependant, ce mince salaire, inférieur encore à celui du rhéteur, l’inepte surveillant de l’élève commence par prélever dessus sa part, et celui de qui on le touche garde la sienne. Cède, Palaemon, souffre ces prélèvements, comme celui qui brocante les nattes d’hiver. Au moins tu ne perdras pas ta séance commencée au milieu de la nuit, à une heure dont ne voudrait ni l’artisan ni celui qui enseigne à effiler la laine avec un fer oblique ; et ce ne sera pas en pure perte que tu auras respiré l’odeur d’autant de lumignons que tu avais devant toi d’enfants, avec leur Horace décoloré et leur Virgile tout noir de suie. Rares sont les honoraires qui s’obtiennent sans une enquête du tribun. Vous autres, parents, vous imposez des conditions sévères. Il faut que le maître soit familier avec les règles de la langue, qu’il sache l’histoire, qu’il connaisse sur le bout du doigt tous les auteurs, qu’interrogé à brûle-pourpoint tandis qu’il s’achemine vers les thermes ou les bains de Phébus, il nomme la nourrice d’Anchise, qu’il dise le nom et la patrie de la belle-mère d’Anchemolus, combien Aceste vécut d’années, combien il donna aux Phrygiens d’outres de vin de Sicile. Exigez qu’il façonne comme avec le pouce ces caractères souples encore, ainsi qu’on sculpte un visage dans de la cire. Exigez qu’il soit aussi un père pour cette cohue d’enfants, qu’il empêche les jeux déshonnêtes, les libertés réciproques. « Ce n’est pas chose facile que de surveiller les gestes de tant d’enfants et leurs yeux qui clignotent vers la fin. – Cela, c’est votre affaire », lui répond-on ; « et, l’année révolue, recevez juste autant d’or que le peuple en fait donner au cocher victorieux ! »
Satires, VII, 215-243
Le « rhéteur » initie les étudiants à l’art oratoire en leur faisant composer des « déclamations » (à propos des tyrans, ou d’Hannibal, ou de sombres affaires d’empoisonnement) et en leur enseignant les concepts de la rhétorique (« couleurs », genres, questions, traits…). Les classes surchargées, la stupidité des élèves (au dire du satiriste) et la pingrerie des parents rendent le métier fort ingrat. D’où le conseil de quitter un emploi qui rapporte si peu ! L’auteur est écœuré par l’égoïsme de certains riches, qui ne reculent pas devant les plus folles dépenses quand il s’agit de leur bien-être ou de leurs fantaisies, mais qui comptent dès que vient le moment de rétribuer les professeurs de leurs enfants.
MIEUX VAUDRAIT POUR TOI PRENDRE TA RETRAITE
Tu es professeur de déclamation ? Faut-il que Vettius ait un cœur de bronze, quand une classe surpeuplée exécute les cruels tyrans ! Tout ce que l’élève vient de lire assis, il va le rabâcher encore debout, et répéter dans les mêmes termes la même cantilène. C’est de ce chou cent fois resservi que meurent les malheureux maîtres. La « couleur » qui convient, le genre auquel la cause appartient, le point cardinal de la question, les traits que pourra peut-être décocher l’adversaire, ils veulent tous savoir tout cela – quant à le payer, personne n’y consent. « Ton salaire ? Qu’est-ce que j’ai donc appris ? – Oui, bien sûr, c’est la faute du maître, si rien ne bat sous la mamelle gauche de ce jeune lourdaud, vrai roussin d’Arcadie, qui tous les six jours me bourre ma pauvre tête de son redoutable Hannibal, quel que soit le sujet dont celui-ci délibère – doit-il, après Cannes, marcher sur Rome ou bien, rendu prudent par les pluies et les coups de tonnerre, va-t-il faire faire demi-tour à ses cohortes trempées par l’orage ? Fixez la somme que vous voudrez et je la paie sur place : combien dois-je donner pour que son père consente à l’écouter autant de fois que je l’ai fait ? » Voilà ce que crient à l’unisson six rhéteurs et plus encore ; et les voilà réduits à plaider pour de bon ; il n’est plus question de ravisseur, de poison versé, de mari coupable et ingrat, de drogue qui rend la vue aux vieillards aveugles.
Il prendra donc, de son propre chef, sa retraite, si mes conseils sont capables de l’émouvoir, et il cherchera une autre carrière, celui qui, des pacifiques combats de la rhétorique, descend aux luttes du forum pour ne pas perdre la misérable somme avec laquelle s’achète un bon de blé au rabais, car tel est le plus riche salaire qu’il reçoit. […] Pour se bâtir des bains, on dépense six cent mille sesterces ; davantage pour un portique où le maître se fera véhiculer en cas de pluie. Voudriez-vous qu’il attendît le beau temps et qu’il laissât éclabousser ses bêtes de boue toute fraîche ? C’est bien mieux là ; le sabot de sa mule pimpante y reste impeccable. Que d’un autre côté s’élève une salle à manger, soutenue par une longue colonnade en marbre de Numidie, qui recueille les rayons du soleil d’hiver. Si cher que lui revienne la maison, il aura aussi un maître d’hôtel habile à l’aménagement des plats et un cuisinier expert aux ragoûts. À côté de ces prodigalités, deux mille sesterces au plus suffiront à un Quintilien3. Ce qui coûtera le moins cher à ce père, c’est son fils.
Satires, VII, 150-188
Plaute
Pistoclère se rend à un festin chez la courtisane Bacchis, au grand désespoir de son précepteur Lydus, qui lui fait des remontrances et essaie de le retenir. Poussé à bout, le jouvenceau laisse échapper la vérité des choses dans la réplique finale.
QUAND L’ÉLÈVE S’INSURGE
LYDUS. – Voilà un bon moment, Pistoclère, que je te suis sans rien dire, observant ce que tu veux faire dans ce costume. Car, me protègent les dieux ! dans cette ville Lycurgue lui-même serait, je crois, capable de succomber au vice. Où vas-tu de ce pas, en remontant la rue, avec un tel équipage ?
PISTOCLÈRE (Montrant la maison de Bacchis.) – Là.
LYDUS. – Comment, là ? Qui est-ce qui habite là ?
PISTOCLÈRE. – L’Amour, le Plaisir, Vénus, la Grâce, la Joie, les Ris, les Jeux, les Doux-Propos, les Doux-Baisers.
LYDUS. – Qu’as-tu affaire avec ces dieux ruineux ? […] Te voilà perdu, et moi-même avec toi, perdu aussi tout mon effort. T’avoir si souvent montré le droit chemin, en pure perte !
PISTOCLÈRE. – Bah ! Si tu as perdu ton temps, j’en ai fait autant du mien. Tes leçons ne m’ont pas profité plus qu’à toi-même.
LYDUS. – Quel cœur endurci !
PISTOCLÈRE. – Tu m’assommes. Tais-toi, Lydus, et suis-moi.
LYDUS. – Voyez-moi ça s’il vous plaît ! Il m’appelle Lydus au lieu de me dire : mon précepteur !
PISTOCLÈRE. – Voyons ; serait-il raisonnable, quand ton élève serait attablé dans cette maison, couché près de sa maîtresse, et l’embrassant amoureusement, en présence des autres convives, serait-il convenable, dis-moi, qu’un précepteur fût de la partie ?
LYDUS. – C’est donc pour cela que tu as acheté toutes ces provisions ? Miséricorde !
PISTOCLÈRE. – Je me plais du moins à l’espérer : l’événement est dans la main des dieux.
LYDUS. – Et tu auras une maîtresse ?
PISTOCLÈRE. – Tu le sauras quand tu le verras.
LYDUS. – Morbleu non, tu n’en auras pas, je ne le souffrirai pas. Je vais à la maison.
PISTOCLÈRE. – Lâche-moi, Lydus, ou gare à toi.
LYDUS. – Comment, gare à toi ?
PISTOCLÈRE. – Je ne suis plus d’âge à être régenté.
LYDUS. – Quel plaisir j’aurais à me jeter dans un gouffre ! Je vois bien plus de choses que je n’aurais voulu. Mieux vaudrait pour moi en avoir fini avec l’existence. Un élève menacer son maître ! Ah ! foin de ces écoliers qui ont trop de sang dans les veines ! Celui-ci abuse de sa force pour malmener une faible créature comme moi… […] Il a perdu tout sens du respect. Sur ma foi, tu as fait une acquisition peu souhaitable pour toi, en acquérant pareille impudence. C’est un homme perdu. Ne te souvient-il pas que tu as un père ?
PISTOCLÈRE. – Suis-je ton esclave, ou es-tu le mien ?
Les Bacchis, 109-162.
Libanios
Il suffit d’exagérer à peine le paradoxe pour démontrer que la condition de « sophiste » (professeur de rhétorique) est une forme d’esclavage.
ESCLAVE DE TOUS
Un sophiste est sans contredit un Sisyphe peinant à son rocher, comme celui d’Homère. Il dispense l’éloquence et la recueille : il la recueille dans les livres et la dispense par sa bouche. Il est esclave non seulement de tous ceux sur lesquels il exerce son autorité, mais aussi de la multitude des pédagogues, de la multitude des parents, d’une mère, d’une tante, d’un grand-père. Et s’il ne change pas les élèves, fussent-ils de pierre, en autant de demi-dieux, s’il ne trouve pas dans son art le moyen de vaincre la nature, un flot d’accusations variées jaillit de tout côté, et il sent la nécessité d’incliner le front vers la terre, non pas qu’il soit dépourvu d’arguments, mais afin d’apaiser un interlocuteur trop prompt aux reproches. Il est aussi l’esclave des factionnaires placés aux portes de la cité, ainsi que de la caste des aubergistes. Il se soumet aux uns, pour qu’on ne dise pas du mal de lui aux étrangers qui arrivent, aux autres, pour que les voyageurs qu’ils hébergent entendent des rapports élogieux sur son compte. Les premiers comme les seconds, en effet, et même des personnes de condition plus modeste encore, peuvent causer du tort à l’atelier de chaque sophiste. Celui-ci, par ses cajoleries, cherche à séduire aussi bien celui qui arrive de l’étranger que celui qui va quitter la ville, par crainte que le premier ne mène un combat rapproché et ne sape les fondements de l’école et que le second ne répande à la volée des bruits fâcheux à son sujet sur toute l’étendue des contrées qu’il parcourra. Il est aussi soumis à la plus écrasante des autorités, celle du Conseil de sa cité. Il suffit aux conseillers d’un texte de quelques lignes pour l’élever ou l’abaisser, pour jouer avec sa situation dans un sens conforme à leur humeur, pour le chasser, si telle est leur fantaisie, ou lui susciter une foule de rivaux ; ils peuvent encore recourir à des moyens qui, si insignifiants qu’ils paraissent, lui créent des ennuis considérables. S’il veut échapper à ces dangers, il doit assurément ne pas être inexpert dans l’art d’être esclave ! Et à la porte du palais des gouverneurs il passera de longs moments à flatter les portiers. Si on le repousse, il ne protestera pas et, si on l’introduit, il en aura une prodigieuse reconnaissance. S’il traite avec de tels égards le préposé aux portes, comment se comportera-t-il devant le pilote aux ordres duquel tout le palais obéit ?
De l’esclavage, 46-49